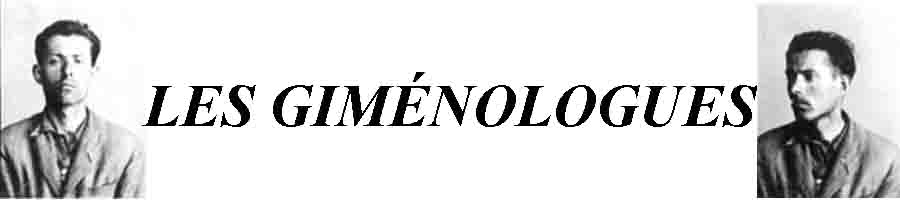Cesar M. Lorenzo.
Le mouvement anarchiste en Espagne. Recension de Freddy Gomez.
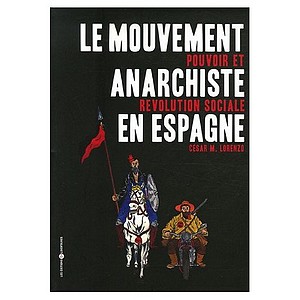
Pouvoir des anarchistes
et anarchistes de pouvoir
Comme toute construction humaine, l’anarcho-syndicalisme espagnol a produit ses mythes et ses héros. Parmi eux, une guerre civile éternellement sublimée comme paradigme du peuple en armes et Durruti comme figure indépassable de l’héroïsme prolétarien. Le mythe n’est pas mensonge, il est reconstruction fantasmée. L’interminable exil - extérieur et intérieur - où s’étiola, trente-cinq ans durant, la diaspora libertaire espagnole, figea sa légende, sans doute pour ne pas sombrer tout à fait, en des temps de cimetières sous la lune.
Le revers de la médaille, c’est que, ce faisant, il fallait que le récit des combats passés collât avec l’idée, fausse, qu’on voulait s’en faire. D’où la lecture partielle - et partiale - qu’il induisit et la hiérarchie qu’il opéra, quitte à passer à la trappe ce qui gênait son bel - mais vain - ordonnancement épique. L’intégration bien réelle de la CNT-FAI à l’appareil d’État républicain, par exemple, fut longtemps présentée soit comme une nécessité relevant des seules circonstances imposées par la guerre civile, soit comme une erreur donnant la juste mesure de la trahison des élites qui la dirigeaient. De fait, elle fut, à la fois, bien plus et bien moins que cela. Ceux qui théorisèrent ce grand écart, Horacio Prieto (1902-1985) en tête, en portèrent, devant l’historiographie libertaire, le stigmate définitif. Il est vrai que, pour ce qui le concerne, il avait singulièrement aggravé son cas en faisant de cette « politisation » de l’anarchisme l’axe central d’une stratégie d’après-guerre, inscrite dans la fondation d’un « Parti libertaire » qui se heurta, globalement, à l’incompréhension générale de ses diverses et rivales composantes.
Quant parut, en 1969, la première version du livre de César M. Lorenzo, Les Anarchistes espagnols et le pouvoir 1868-1969 ([1]), reproche fut fait à son auteur de rehausser inconsidérément la figure et les thèses d’Horacio Prieto, reproche mâtiné de suspicion quand on s’enquit que César n’était autre que le fils d’Horace. Au fond, le prétexte était tout trouvé pour descendre en flèche un livre assurément dérangeant et s’inscrivant à contre-courant de la production d’époque. Qu’on en juge : C. M. Lorenzo prétendait faire pièce à l’idée communément admise, alors, par la majorité des libertaires de toutes obédiences, que l’envoi de ministres anarchistes au gouvernement avait été la plus grossière erreur commise par la CNT-FAI. D’après lui, l’erreur consistait, au contraire, à y être allé à reculons et trop tard.
Quelque trente-cinq ans plus tard, C. M. Lorenzo nous offre une version entièrement remaniée et très augmentée de son livre de 1969, repris sous le titre Le Mouvement anarchiste en Espagne. Pouvoir et révolution sociale ([2]). Comme s’il lui restait à dire, ou à reprendre. Comme si sa part de vérité, toujours mise à mal, méritait insistance. Comme si l’urgence durait toujours. « De là d’ou je viens, précise l’auteur en introduction d’ouvrage, il me fallait parler. Pour lutter contre l’oubli, contre l’erreur, contre l’injustice du sort. Tout simplement. Et pour maîtriser, par l’écriture, une souffrance intérieure... » La cause est donc entendue : ce travail est bien l’affaire d’une vie et cette ténacité mérite respect.
D’un livre à l’autre, la thèse de C. M. Lorenzo n’a pas varié : elle stipule l’incapacité chronique de l’anarcho-syndicalisme espagnol à saisir les mécanismes de pouvoir au plus près de leur complexe réalité, d’où son balancement permanent entre le tout et le rien. Autrement dit, l’apolitisme radical qui faisait, à ses yeux, l’essentiel de sa doctrine l’aurait grosso modo mis en marge de l’histoire, et ce jusqu’à ce que l’épreuve des faits le fasse favorablement bouger. Quelque six cents pages grand format durant, c’est cette thèse que l’auteur s’emploie à étayer, et parfois même à instruire. Car il faut en convenir, il y a, chez C. M. Lorenzo, une telle certitude de détenir la vérité que le ton péremptoire qu’il adopte parfois peut irriter le lecteur. Pour notre part, nous eussions préféré qu’il en rabatte, et ce d’autant que la distance qui sépare les deux éditions de son livre aurait pu être mise à profit pour nuancer en bien des aspects, et au vu des nombreuses études publiées depuis 1969, le jugement porté sur un mouvement dont la vraie richesse résida précisément dans sa capacité d’expérimentation multiple et contradictoire. Au point que, si l’anarchisme espagnol reste encore un objet d’étude passionnant, c’est d’abord parce qu’il se coltina à l’histoire, à la question politique et au pouvoir, autrement que théoriquement. C’est même ce qui fit son irréductible spécificité.
Cette critique ne saurait, cependant, induire une quelconque réserve sur l’intérêt évident et la valeur documentaire - considérable - de l’ouvrage de C. M. Lorenzo. Divisé en quatre parties - « L’essor du mouvement ouvrier libertaire », « « Panorama de la révolution de juillet 1936 », « La guerre civile dans la guerre civile », « Le temps de la décadence et du repli » -, complété d’intéressantes notes finales et doté d’une riche bibliographie, il scrute à la loupe l’infinité de conflits internes et de fausses réconciliations qui jalonnèrent sa longue histoire.
De l’opposition violente entre « collectivistes » et « communistes » au XIXe siècle à celle qui provoqua l’éclatement de la CNT de l’après-franquisme entre « rénovés » et « historiques », en passant par l’affrontement entre « trentistes » et « faïstes » au début des années 1930 et les multiples déchirures qu’engendra le long exil, C. M. Lorenzo se livre à un relevé exhaustif de cette dialectique de l’affrontement interne, dont il voit - par trop mécaniquement à notre avis - la principale cause dans une rivalité éternellement rejouée entre pragmatisme syndical, d’un côté, et exaltation révolutionnaire, de l’autre. Fortement idéologique, cette grille de lecture ne permet pas toujours de saisir la particularité de tel ou tel conflit, et encore moins le fait que, de l’un à l’autre, les « radicaux » d’hier devinrent parfois les « possibilistes » du lendemain, ou vice versa.
A propos de la FAI, fondée en 1927, à laquelle C. M. Lorenzo attribue une part importante dans l’accroissement des luttes internes à la CNT, il introduit, cependant, une différenciation entre la FAI proprement dite - l’ « authentique », précise-t-il -, qui se serait essentiellement occupée de maintenir la flamme d’un anarchisme culturel, et le « faïsme », sorte de nébuleuse - « amalgame plus ou moins cohérent », écrit-il - où auraient influé et se seraient combattus divers « intégristes » : les « intransigeants contemplatifs » (Felipe Alaiz, José Peirats), les « kropotkiniens communalistes » (la famille Urales) ou « industrialistes » (Diego Abad de Santillán et le groupe « Nervio ») et les « anarcho-bolcheviks » (Juan García Oliver et le groupe « Nosotros »). Là encore, une lecture par trop idéologique de l’histoire débouche sur une approche conceptuellement contestable, car s’il fait peu de doute que des stratégies de contrôle existèrent bien de la part de certains réseaux « faïstes », le « faïsme » en lui-même représenta d’abord l’expression, parfois brouillonne, d’un anarcho-syndicalisme radicalisé convaincu que la révolution était au bout de la « gymnastique révolutionnaire ». Et quoi qu’on pense des folles illusions qu’il trimballa et des nombreuses erreurs tactiques qu’il commit, ce « faïsme »-là, dont les adeptes n’avaient souvent rien à voir avec la FAI elle-même, engrangea quelques succès, dont le principal fut sans doute la création des « Cadres de défense » de la CNT, organisation paramilitaire dont le rôle fut déterminant en juillet 1936. Car si le mythe s’accorde à voir, en cette date, une irruption du peuple en armes sur le devant de la scène, la simple lecture de l’événement prouve, au contraire, que ce peuple - sans armes - attendit le plus souvent que le feu nourri des « Cadres de défense » de la CNT nettoie les rues de Barcelone pour les investir drapeaux au vent.
Par une de ces ironies dont l’Histoire a le secret, cette révolution tant espérée par la CNT prit la forme d’une résistance à un coup d’Etat militaire. Autrement dit, ex abrupto, les « rebelles » (fascistes) cherchaient à abattre la République et les « réguliers » (républicains) à la défendre. On avouera que le scénario avait tout pour nuire au film. C’est pourtant ainsi qu’il se présenta, dès juillet 1936, et qu’il se déroula jusqu’à mars 1939. On pouvait rêver mieux pour partir à l’assaut du ciel. L’hypothèque pesa son poids de realpolitik.
Pour C. M. Lorenzo, la cause est entendue : localement, la CNT-FAI - car, dès lors, les deux entités n’en firent qu’une - accepta, partout et immédiatement, de collaborer avec les autres forces de gauche pour abattre le fascisme et, partout et immédiatement, elle révisa, de ce fait, son apolitisme traditionnel pour participer, sous des appellations diverses, à des structures de pouvoir. Il allait donc de soi que ce mouvement se prolongeât et aboutît à son intégration, comme force décisive, à l’appareil d’État pour défendre ses propres positions en matière de stratégie militaire et de changements sociaux à promouvoir. Ainsi, mise au pied du mur, la CNT-FAI aurait, ipso facto, reconnu l’inanité de quelques-uns de ces postulats de base, dont un anti-étatisme mal compris. Qu’elle admît cet aggiornamento sous le poids des circonstances prouve, à ses yeux, qu’elle avait encore, à défaut d’illusions, quelques difficultés à trousser les principes. Hélas ! pour elle, insiste C. M. Lorenzo, le temps perdu à oser franchir la dernière étape - celle de l’intégration au gouvernement d’une République assiégée - lui fut politiquement fatal.
Sous la plume de l’historien, sérieux comme un pape comme il se doit, C. M. Lorenzo ne déteste pas jouer les provocateurs, ce qui fit écrire à José Peirats ([3]), lors de la première édition de son ouvrage, qu’il s’agissait là « du livre le plus anti-anarchiste émanant de notre propre camp » jamais écrit. Sans aller jusque-là, il faut bien reconnaître que son auteur pousse parfois le bouchon un peu loin et que, s’il y prend visiblement un certain plaisir, il reste là encore prisonnier d’une lecture strictement idéologique d’une histoire si lourde d’hésitations, de doutes, de demi-échecs, de pieux mensonges et de vrais abandons, qu’aucune vérité révélée ne saurait la traduire sans la trahir. Or, c’est bien là que le bât blesse, car tout concorde à penser que C. M. Lorenzo n’a pas frotté ses certitudes aux vents contraires d’une épopée contradictoire, mais qu’il l’a pliée à ses propres schèmes, au risque de n’en comprendre que la langue d’une caste érigée en porte-parole bureaucratique d’une militancia progressivement privée de mots pour dire l’ampleur d’une réalité qui lui échappait et d’une défaite qu’elle sentait venir. Car, après tout, c’est avec des ministres anarchistes au gouvernement que progressa, irrésistiblement, la contre-révolution, dont Mai 37 reste la date clé.
S’il faut lire et parler de ce livre avec la même passion qui a présidé à son écriture, c’est qu’il est probablement unique en son genre. Pour sûr, il en apprend beaucoup sur les luttes d’influence, les coups bas et les rancœurs qui traversèrent un mouvement dont la vraie force fut sans doute d’avoir attiré à lui ce que comptaient de mieux le prolétariat et la paysannerie pauvre de son époque. Pour sûr, il en évoque les hauts faits et les petites misères avec le même souci de ne pas les séparer. Pour sûr, il tient, et c’est heureux, le mythe à distance avec le constant désir de ne pas y céder. Pour sûr, solidement documenté, il constitue une somme dont aucun chercheur ou simple curieux ne saurait se passer.
Reste, cependant, qu’on ne trouvera pas, en le lisant, une seule raison de comprendre pourquoi le rêve émancipateur, collectivement porté par des exploités conscients, s’exprima, avec une telle intensité, au sein de ce mouvement. Et moins encore pourquoi il s’y donna libre cours, le temps d’un bref été de l’anarchie, en dépit de et parfois contre ses propres leaders, dont Horacio Prieto, alors secrétaire général de la CNT.
Freddy Gomez
(Le Monde libertaire, n° 1 446, 14/20 sept. 2006)
recension du livre de César M. Lorenzo
publié aux éditions libertaires en juin 2006
le mouvement anarchiste en Espagne.
[1] Paris, Editions du Seuil, 1969.
[2] Notons, pour la petite histoire, qu’à la différence de la première édition, qui tomba à un moment où les éditeurs commerciaux faisaient leur beurre en surfant sur la vague de l’après-Mai, cette réédition ne trouva pas preneur, ce qu’on comprend aisément au vu de la médiocrissime production éditoriale qui encombre, aujourd’hui, les étals. Saluons donc l’effort des Éditions libertaires pour que puisse paraître ce gros volume.
[3] Auteur d’une indispensable histoire de la CNT pendant la révolution espagnole - La CNT en la Revolución española, trois tomes, Paris, Ruedo ibérico, 1971 -, dont il existe, en français, une édition abrégée, malheureusement épuisée : Les Anarchistes espagnols. Révolution de 1936 et luttes de toujours, Toulouse, Repères-Silena, 1988, 334 p.