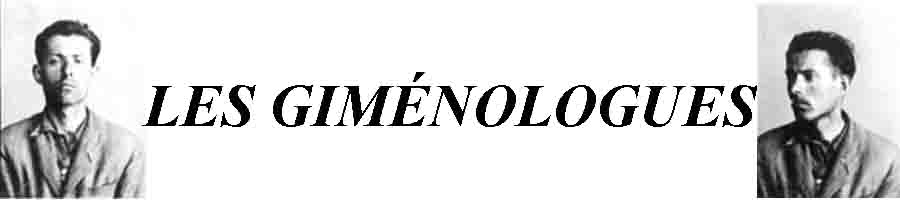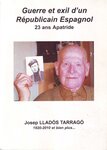
Revenons aux jours qui suivirent le 19 juillet 1936. Au village, on l’ignorait, mais à Barcelone on savait que Saragosse était entre les mains du général Cabanellas considéré jusqu’alors comme démocrate.
Revenons aux jours qui suivirent le 19 juillet 1936. Au village, on l’ignorait, mais à Barcelone on savait que Saragosse était entre les mains du général Cabanellas considéré jusqu’alors comme démocrate. (Son ordonnance était native d’Alcarràs.) Aussitôt, une colonne s’organisa avec Durruti à sa tête. Ce dernier venait de perdre son grand ami Ascaso durant les combats dans les rues de la capitale catalane. Cette colonne se dirigea vers l’Aragon dans des voitures, des camions et des autobus recouverts d’inscriptions « CNT-FAI » ou « UHP » Unión Hermanos Proletarios (Union Frères Prolétaires). De nombreux jeunes se joignaient à elle dans les villages où elle passait. Chez nous, que je sache, personne ne partit à ce moment-là. Des hommes armés montaient des gardes et effectuaient des contrôles en divers points du village.
Au début du mois de septembre, le premier comité partit pour le front car ici tout était redevenu calme. Ils furent remplacés par un autre comité de volontaires : des camarades plus mûrs mais plus récents dans le syndicat. Jour et nuit, des jeunes partaient rejoindre la Colonne Durruti. La fièvre était si grande dans la jeunesse qu’elle me prit moi aussi. Un soir, avec deux copains du village, nous rejoignîmes la route et arrêtâmes un camion qui nous emmena à la Colonne - onzième centurie - où étaient déjà incorporés au moins une quinzaine d’amis d’Alcarràs. J’avais seize ans et sept mois, et je reconnais que c’était de l’inconscience totale car je quittais ma mère, mon père, mon grand-père, ma petite sœur... pour me retrouver tout tranquillement dans une bergerie près d’Osera avec mes aînés du village et d’autres qui venaient de je ne savais où.
Il y avait un vieil Anarchiste qui faisait la cuisine avec notre aide. En ce temps-là, on mangeait encore à sa faim. Je me souviens du café du matin avec des tartines de pain frit saupoudrées de sucre. On n’avait jamais mangé de ça chez moi.
Après les dîners, le temps étant encore agréable, on sortait s’asseoir et le vieux Pina nous faisait une sorte de conférence, toujours instructive, au sujet des idées « acrates ». Nous comprenions que c’était un homme d’une certaine expérience de l’idéal comme de la lutte ouvrière, et qu’il avait dû connaître la prison plus d’une fois. Après son petit discours, il allait se coucher et la jeunesse reprenait ses droits. Dans un groupe, il y en a toujours un pour faire rire les autres et la bonne humeur régnait pour un bon moment.
Il y avait beaucoup d’hommes au front, bien que celui-ci ne fût pas encore très défini, et nombreux étaient ceux qui ne possédaient pas d’arme. Au bout de trois semaines dans la bergerie, nous allâmes à quelques-uns au quartier général pour demander des fusils. Une fois arrivés, nous expliquâmes que nous étions de la onzième centurie et que nous n’avions pas d’armes. À cet instant arriva Durruti qui, non comme un chef mais comme un camarade, nous dit :
« Encore trois d’Alcarràs ?
- Oui !
- Je n’ai pas d’armes à vous donner, et vous n’êtes pas les seuls !
Et sans le moindre salut militaire, nous nous séparâmes avec un salut amical.
Quelques mots sur Durruti et sur tant d’autres tombés en défendant les intérêts des opprimés et qui appartenaient à la Confédération Nationale du Travail sans se référer à aucun parti politique. Les partis ont d’ailleurs toujours calomnié l’action ouvrière de la CNT. Il est vrai que Durruti est allé de nombreuses fois en prison tant pour son action militante que pour ses attaques de banques à main armée. Mais il ne gardait jamais rien pour lui-même : cela servait à aider le syndicat, les athénées et les familles dans la misère. Lors des premiers jours de la rébellion à Barcelone, il était en première ligne avec des milliers d’ouvriers. (C’est là que mourut son grand ami Ascaso.) Tant qu’il vécut, il prit une très grande dimension pour les ouvriers de Catalogne. Du front d’Aragon, il gagna Madrid avec des volontaires de sa colonne et y fut tué. On ne sait toujours pas de quelle manière précise. Dans sa valise, on ne trouva que quelques effets personnels. Malgré la mauvaise réputation que lui avaient faite les politiciens de tous bords, il n’avait jamais volé le peuple travailleur.[1]
Après l’entrevue avec Durruti, de retour à la centurie, nous commençâmes à assurer des tours de garde sur la route Bujaraloz-Zaragoza, nuit et jour par relèves. Les mêmes fusils servaient à tous à tour de rôle.
Les semaines et les mois passèrent et, au printemps 1937, j’obtins une permission avec d’autres. Je ne me rasais pas et j’avais une barbe rousse depuis mes 17 ans, comme mes fils l’auront aussi. Comme nous étions un peu payés, j’achetai une guitare que je laissai à la maison. Je ne sais pas ce qu’elle est devenue. Cependant, je ne savais absolument pas jouer de ce magnifique instrument. Mes parents ne me dirent rien sur ma façon de mener ma vie. J’assurai quelques gardes au village. Avaient-ils peur ? J’en doute.
La permission terminée, retour au front. Dans la colonne, on commençait à parler de militarisation. Chacun sait que les libertaires sont apolitiques et antimilitaristes. À la 11ème centurie, il y eut beaucoup de discussions plutôt contre. (Combien a-t-on vu de généraux descendre dans la rue dans l’Histoire d’Espagne ?) Mais c’était une guerre et les forces confédérales l’acceptèrent pour le bien de l’unité des forces anti-fascistes, en laissant libres de rentrer chez eux ceux qui ne l’acceptaient pas. C’était mon cas et je rentrai à la maison. C’est ce que m’avaient conseillé les amis du village de la centurie, étant donné mon jeune âge. Je m’intégrai de nouveau au syndicat où je passai la plupart de mes nuits.
Mon frère aîné avait déjà été mobilisé. Étant donné que je me couchais tard, j’allais travailler à Graninell vers les neuf heures du matin. Ce qui me faisait honte, car la tradition paysanne veut que l’on aille aux champs avant le lever du soleil. Je faisais encore quelque chose jusqu’à midi, je mangeais et après ça : sieste. Longue sieste. C’est-à-dire qu’à ce moment-là, je menais une vie totalement irresponsable. Je faisais ce que mon petit cerveau voulait. Mes parents ne me firent aucune observation, mais j’étais une véritable catastrophe pour les travaux de la maison.
De retour du front, je rencontrai les Jeunesses Libertaires que les jeunes avaient créées, et quand vint le moment de renouveler le petit comité, l’assemblée me nomma secrétaire. J’étais alors un peu mieux formé grâce aux conférences du vieux Pina.
Mon frère n’était toujours pas revenu à la maison. Mon grand-père qui ne pouvait plus travailler, mon père très malade (il mourra en octobre 37), ma mère et une petite sœur de 7 ans : voilà ce qu’était mon cadre familial. Et moi qui devais être leur soutien, comme je ne le comprenais pas, je ne faisais rien. C’est maintenant que je comprends combien ils auraient pu m’en vouloir pour être parti au front sans rien leur dire. Mon père alla de pire en pire, et lors de ses derniers instants il me vint à l’idée de lui dire : « Père, regarde, voilà le Ramonet qui arrive ! » pour le ranimer un peu. Je crois qu’il a eu une petite réaction, alors qu’il semblait ne plus entendre et ne parlait plus. Je ne sus pas et ne saurai jamais si c’était vrai.
Les années ont passé et j’y pense souvent. Et je reste convaincu qu’à cause de mon mauvais comportement, il ne voulait même pas entendre ma voix. Je me reproche toujours de ne pas l’avoir compris et de ne pas avoir été à la hauteur de la situation familiale.
Comme on dit, il faut que jeunesse se passe, et pour moi comme pour les autres elle a passé. Je me surprends à regarder le chemin parcouru avec les années, vie de responsable d’une famille de cinq enfants, plus un recueilli à l’âge de sept ans, vie de beaucoup de travail pour subvenir aux besoins de tous. Si mes parents avaient connu ça, mon autre vie responsable, ils auraient finalement été contents de leur fils. Au fond, pendant ma jeunesse inconsciente, je n’avais pas mauvaise mentalité. Ce qui me reste de ma jeunesse, ce sont mes idéaux humains.
Aussitôt après la mort de mon père, chose naturelle, je suis allé le dire à ma petite sœur qui ne comprit pas bien à cause de son jeune âge. Ma mère pleurait. Mon grand-père, lorsqu’il sut la mort de son fils, ce fut encore pire que d’habitude, lui qui pleurait déjà lorsque les cloches sonnaient pour quelqu’un du village étranger à la famille. Je reconnais que lors de ces moments si tristes pour nous, j’eus une réaction qui m’a toujours étonné moi-même. Je me dis : « Si nous nous mettons tous à pleurer, qu’est-ce qui va se passer ici ? » et je ne pus pas verser la moindre larme. Il se fit un blocage à l’intérieur de moi et il ne sortit pas une seule larme. En revanche, quand je me suis retrouvé seul exilé en France, mon cher père, je l’ai pleuré plus d’une fois et en pleine rue. Le pleurer me faisait du bien et m’apaisait à l’intérieur.
Mon frère Ramón arriva avec une permission pour cause du décès de notre père. Celui-ci était déjà enterré. L’enterrement fut civil, car il n’y avait alors aucun représentant ecclésiastique. Si ceux-ci avaient été du côté des pauvres, ces derniers n’auraient eu aucune raison de leur vouloir du mal. Mais c’était le contraire.
L’enterrement civil ne changea rien au comportement du peuple qui vint en masse l’accompagner au cimetière. C’est ainsi que le village manifesta l’estime qu’il portait à ma famille.
Comme je l’ai déjà dit, je fus nommé secrétaire des Jeunesses Libertaires. En soirée, nous discutions, nous lisions quelques circulaires lors des réunions. Mais je n’ai jamais su d’où était sortie la radio qui s’y trouvait. Une rumeur disait qu’elle avait été réquisitionnée chez le Dr Mario Huguet, le médecin pacifiste, un médecin généraliste très connu et aimé des habitants d’Alcarràs. Bien qu’il pût être considéré comme une personne privilégiée, personne ne lui dit jamais rien et il continua à visiter ses malades à pied, comme toujours. Il possédait quelques arpents de terre, mais il ne faisait aucune politique. Sa radio passa de l’individuel au collectif.
Au printemps 1938, le front d’Aragon ne peut résister à la poussée des forces bien ravitaillées en armes par l’Allemagne et l’Italie fascistes ainsi que par le Portugal de Salazar. À Alcarràs, il n’y avait pas de forces militaires au repos et pas de fabriques de matériel de guerre. Cela n’empêcha pas qu’un dimanche d’été les avions italo-allemands vinrent bombarder le village. Trois avions la première fois. Il s’en présenta trois autres vingt minutes plus tard. Ils tuèrent presque toute la famille de Cal Milio, la Filomena del Tano et notre voisine de Cal San. Le fait d’avoir été un peu au front me servit à cette occasion. Quand j’entendis les avions, je pris la bicyclette que j’avais achetée à mon retour et je pris la direction du bas du village et je m’allongeai dans un fossé à sec. J’attendis là que cela se calme en pensant à ma mère, ma sœur et mon grand-père. Je sortis enfin du fossé et repris ma bicyclette jusqu’à la maison. Je me rendis compte que beaucoup de maisons s’étaient écroulées. Il n’y avait personne à la maison, et je me dirigeai vers notre aire de battage. C’est au bout de la calle del Calvario que je trouvai la señora de Cal San, tuée par une bombe. Je ne les retrouvai pas sur notre aire et m’en allai vers l’autre, deux cent mètres plus loin. Ils y étaient avec la tía Malena, la sœur de la mère de ma mère.
Peut-être la peur m’avait-elle donné un peu de compréhension. Nous étions tous les quatre réunis et saufs. Nous fûmes d’accord pour prendre les mules et la charrette, y charger le nécessaire et direction le mas de Graninell. Ce soir-là, il ne resta personne au village. Au mas, nous nous installâmes tant bien que mal. L’inquiétude était grande et les premiers soldats en retraite commencèrent à passer, chaque jour plus nombreux et plus faméliques, pieds nus et sales. Quelque part sur le Segre, certains tentèrent de traverser et on les entendit crier en se noyant. Nombreux sont ceux qui perdirent leur vie dans ce Segre que les Carrasinos aimaient tant quand on pouvait boire son eau, y pêcher et y nager.
Nous étions tous les quatre au mas et les mules à leur place. Nous craignions qu’on nous les prenne, mais cela n’arriva pas. Nous laissions libres une poule et ses poussins, et c’était eux les plus heureux : pour eux, il ne se passait rien. Deux jours plus tard et de nuit, je retournai à Alcarràs chercher ce que ma mère et mon grand-père me demandaient. En arrivant, j’avais l’impression d’entrer dans un cimetière : maisons détruites, sans lumière électrique, on voyait des lueurs par-ci par-là : des habitants qui comme moi étaient revenus chercher quelque chose. Je pris ce qu’on m’avait dit et passai au secrétariat des Juventudes. J’y pris la liste des jeunes et tous les papiers qui pouvaient compromettre quelqu’un, sept cents pesetas de la caisse, le tampon, et tout ça dans un sac et retour au mas à pied. Mes parents furent très heureux de me voir revenir. Je donnai les pesetas à ma chère mère pour qu’elle me les garde. La radio était sur la table et je l’y avais laissée. Je m’étais dit que le Señor Mario, le médecin, pourrait la récupérer. Je ne sais rien de plus de lui. Quant au sac et aux papiers, je les enterrai à Graninell et quand je revins en Espagne, et à mon village, et à Graninell, je tâchai de les retrouver. Je ne trouvai rien, le temps les avait fait pourrir. C’était 23 ans plus tard.
On ne pouvait contenir l’offensive fasciste sur la Catalogne, plus les jours passaient, plus les soldats passaient. On pouvait calculer que les troupes de Franco et compagnie, traîtres à la République, bien équipées par les Nazis allemands et les Fascistes italiens, n’étaient pas loin. Aussi, mon grand-père savait que près du barrage des basses eaux il y avait un rocher où l’on pouvait se mettre à l’abri et se cacher. Nous y allâmes et y rencontrâmes d’autres voisins. J’étais très inquiet, je ne voulais pas me laisser prendre par les factieux. Ils auraient été capables de me tuer pour mon appartenance à la CNT avant le 19 juillet 36, pour avoir été volontaire sur le Front et secrétaire des Juventudes Libertarias. Ces trois choses étaient suffisantes en ces temps, en tenant compte que lorsqu’arriva la justice (que j’appelle l’injustice) de Franco, on fusillait vite un homme. La preuve : quatorze du village.
Ce qui se disait dans le camp républicain, et qui était vrai, c’était que quand les troupes de Franco conquéraient du terrain et des villages républicains, elles arrêtaient et fusillaient les plus compromis de ceux qui avaient résisté à leur rébellion, même s’ils n’avaient tué personne, juste pour avoir eu des responsabilités dans des syndicats ou des comités. Et pendant que ma famille se trouvait sous ce rocher, j’allais et venais en pensant à m’en aller et à mes petites responsabilités anti-franquistes. Enfin, je me décidai à parler à ma mère, mon grand-père et ma petite sœur.
Je leur dis : « Madre, je m’en vais ! »
Et elle me répondit : « Où vas-tu aller, malheureux ? »
Elle me donna un morceau de pain et un peu de chocolat qu’elle sortait de je ne sais où, et je profitai du passage de trois autres personnes du village pour m’en aller avec eux. Parmi ces trois, il y avait un oncle éloigné, son amie intime et un garçon plus jeune que moi. Ce qui les faisait partir était plutôt la peur qui les avait pris, car je ne leur connaissais aucune responsabilité, et c’est pour ça que même des gens qui avaient été détenus dans l’église s’en allèrent.
Nous quatre qui suivions le bord du Segre nous décidâmes à le traverser en nous tenant par la main, de l’eau jusqu’à la ceinture. Tout allait bien. Mais arrivés à une dizaine de mètres de l’autre bord, où le débit était plus important, l’eau nous arriva aux épaules. Sur le point de toucher terre, nous étions près d’être emportés par les eaux. Nous eûmes la très grande chance que des soldats des nôtres qui se reposaient sur l’autre rive nous virent et nous tendirent la branche d’un arbre. Ainsi, peu à peu, nous finîmes de traverser en les remerciant du plus profond de nous-mêmes. Et le Segre constitua la ligne de front pour quelques mois.
Les quatre naufragés, nous continuâmes notre chemin vers l’arrière de la zone du front, marchant sur de petits chemins sans savoir où nous allions ni où nous nous arrêterions. Nous rencontrâmes un habitant du village. Il allait seul. Son surnom catalan était Lo Juanet de la Riteta. Son emploi au village : boucher. Nous éprouvâmes de la joie, plutôt de la satisfaction, de nous retrouver. L’heure était plus que grave. En tout cas, cet homme d’environ cinquante ans me dit : « Tonio ! (Au village, ma famille était connue sous le surnom de Cal Tonio) Si tu veux venir avec moi, je vais à Vilafranca del Penedès. Ma famille t’accueillera. » Je lui dis : « D’accord ! » Je n’avais aucune raison de ne pas avoir confiance, et de toutes façons je ne savais pas où aller. Et le Juanet, je le connaissais depuis toujours. Nous nous connaissions tous à l’époque dans les villages.
Et nous voilà partis sans perdre de temps. Arriva la nuit que nous passâmes sous un porche dans un léger froid. Le jour suivant, nous arrivâmes à Vilafranca del Penedès. Nous allâmes à la maison de sa famille, je crois que c’étaient des cousins, et là ils décidèrent qu’il resterait ici et que moi, j’irais dans une autre maison de la même famille. Ils paraissaient de bonnes gens, et ils furent ainsi pour moi. Les jours passaient en les aidant dans ce qu’ils avaient à faire. J’avais une chambre, je mangeais avec eux bien que tout se fît de plus en plus rare. Ils me traitèrent et se comportèrent très bien avec moi. Ce qui fait que le Juanet, voisin du village qui m’amena là, dans cette famille, devint pour moi un protecteur. Depuis lors, encore plus qu’être du même village, il fut un ami très estimé. Et les 23 ans que je passai sans revenir en Espagne ne suffirent pas à me le faire oublier. Je suis allé le voir et, bien que ses yeux ne vissent plus, ces mêmes yeux pleurèrent. Nous ressentîmes une grande joie et parlâmes longtemps des peines passées. Quand j’ai appris sa mort, j’ai eu beaucoup de peine.
Je n’ai jamais su comment ce bon ami avait appris qu’à Vilasar de Mar il y avait quatre hommes de son âge réfugiés de notre village comme nous. Il me proposa d’aller les voir. Le lendemain, nous prîmes le train, et après plusieurs changements, nous arrivâmes là-bas. Ce fut une grande joie pour tous y compris moi, de loin le plus jeune. Nous fîmes bouillir des patates et nous parlâmes tout le temps que nous restâmes avec eux. C’est ce jour-là que j’appris qu’à Vilasar de Mar, tout près de Barcelone, on faisait deux récoltes de pommes de terre par an grâce au climat maritime. À la fin de l’après-midi, nous prîmes de nouveau le train et rentrâmes à Vilafranca. Je suis resté dans ce très joli village, logé dans la maison de l’une de ses familles jusqu’au mois de mars 1938.
Ma classe fut appelée le 1er avril, c’est elle qu’on appela « la classe biberon » tant nous étions jeunes. J’avais 18 ans et 2 mois. Mon bon ami Juanet avait dû en parler avec sa famille et il me dit : « Comme tu le sais, le gouvernement républicain a appelé ta classe, la 41. Si tu veux, tu peux rester ici. Ma famille te cachera. » Il me dit ça sans chercher à m’influencer. Je lui répondis que je préférais me présenter à l’autorité militaire. Le lendemain matin, j’allai remercier les deux familles de m’avoir accueilli et si bien traité. Et Juanet, le visage triste, me dit que nous pourrions nous revoir. Mais il ne me vit plus jamais, car lorsque je revins au village et chez lui 23 ans plus tard, il était aveugle. Mais il a pu m’entendre.
Quand nous nous sommes rencontrés, il allait seul, et moi avec les trois autres avec qui j’avais traversé le Segre. Il n’était ni plus ni moins qu’un habitant d’Alcarràs comme les autres, avec un petit soupçon comme celui provoqué chez les gens par les maquignons, ces personnes qui vivent de l’achat et de la vente de n’importe quoi qui rapporte. Ce petit soupçon ne fut rien de plus qu’un petit sentiment fugace qui traversa mon cerveau, provoqué par son métier. Je n’ai pas eu besoin d’y repenser, ni ne vis aucun détail qui aurait pu m’y faire penser. Au contraire. Comme je l’ai dit plus tôt, il fut mon protecteur durant le peu de temps que nous restâmes ensemble, et il resta mon ami pour toujours. En quittant Vilafranca del Penedès, je ne me rendais pas compte qu’il entrait dans ma vie et mon histoire personnelle.
En quittant Vilafranca, je savais que j’allais à Barcelone pour me présenter, mais je ne savais rien de plus. À l’arrivée dans la capitale catalane, je ne sus pas où me diriger ni ne pensai à chercher un syndicat de la CNT pour qu’on m’oriente. Comme je ne savais pas où dormir ni où manger, je demandai à un passant qui me dit qu’il y avait une caserne un peu plus loin. J’y allai. On m’accueillit, on me donna un peu à manger, et on m’attribua un lit dans lequel, soit dit en passant, j’attrapai mes premiers poux. Le lendemain matin, je me rendis compte que c’était la caserne Karl Marx. Au petit déjeuner du surlendemain, on me dit : « Tu pourras manger et dormir ici dans l’attente de ton affectation. Jusque-là, tu peux aller te promener où tu veux. » Je sortis dans l’espoir de rencontrer quelqu’un du village. Je me retrouvai au pied de la colonne Colomb, où je me fis photographier. Cette photo, je l’ai perdue dans les vicissitudes de la guerre.
Et un jour, en promenant ma solitude, je rencontrai certains jeunes du village qui se retrouvaient chaque jour au même endroit. Nous en eûmes une grande joie et nous donnâmes les nouvelles que nous avions du village et de la situation générale. Je leur dis que je m’étais présenté, vu qu’on avait appelé ma classe, et que j’étais à la caserne Karl Marx. Il se faisait tard, et je devais être rentré à l’heure du dîner. Les autres vivaient chez leurs familles.
Le jour suivant, nous nous revîmes et je leur expliquai qu’un de ces jours ils ne me verraient plus parce qu’on m’aurait envoyé quelque part. Nous nous séparâmes jusqu’au jour suivant. Je crois que nous étions quatre : celui qui s’appelait Sapat ; le Gostinet del Pelletes (de son vrai nom Agostin Salo) ; et je ne me souviens pas du troisième. Moi et Agostin, nous avions le même âge, et le quatrième jour il me dit : « Je vais avec toi ! » Et quelques jours plus tard, nous fûmes encadrés par des responsables qui nous firent monter dans le train en direction de l’ouest de la Catalogne, sans avoir mangé. Nous arrivâmes à notre destination à la fin de l’après-midi. Ils nous firent descendre du train dans un petit village dont je ne connais pas le nom. Ce que je sais, c’est qu’il pleuvait, que nous étions très fatigués et que nous avions très faim, et pas un couvert où se mettre un peu à l’abri. Il y avait des meules de paille dans le secteur et mon ami et moi, qui étions paysans, eûmes vite l’idée de nous faire une place dans la paille. Mais la faim nous dévorait et nous décidâmes que l’un de nous irait au village, histoire de trouver quelque chose à manger. L’autre préparerait l’endroit pour dormir à deux dans la paille. Moi, le fait de demander m’a toujours posé un problème, ce qui fait que c’est le Gostinet qui y alla et qui revint avec 50 grammes de pain que nous mangeâmes. Et, bien à l’abri et très fatigués, nous dormîmes profondément d’un sommeil récupérateur d’énergie, hors d’atteinte de la pluie, du vent et du froid. La nuit nous parut courte. Le lendemain, nous dûmes nous réveiller sans rien pour se laver et se sécher. On nous rappela, mais rien au petit déjeuner. Le ravitaillement brillait par son absence. En revanche, il y avait des kilomètres à faire, et à cinq heures de l’après-midi nous arrivâmes au village qui s’appelle Pons. Petit village catalan qui, au lieu de se voir plein de soldats, aurait préféré travailler tranquillement les terres en paix et dans la joie. Mais nous étions en guerre.
À Pons, nous prîmes contact avec des cuisiniers et une cuisine, et au soir nous mangeâmes autant que nous bûmes quelque chose de pas très consistant et bien clair. Le dîner fut fini. Dans ce village, nous dormions à l’abri, mon ami et moi. Nous eûmes la joie et la surprise que l’un des cuisiniers fût un cousin de Gostinet, ce qui ne veut pas dire que nous étions favorisés. Non, comme les autres, nous avions l’impression qu’il ne nous regardait ni ne nous voyait quand il nous servait. Chose qui était très normale. Ce cuisinier était agriculteur au village et il ne favorisa en rien son cousin, mon ami de guerre.
Nous passâmes huit jours dans ce petit village. Notre occupation pour passer le temps était d’apprendre à marcher en peloton - droite, gauche - et quelques mouvements d’assouplissement. Je marchais quasi-déchaussé. Je cherchai dans les boutiques de chaussures. En 1938, il y avait longtemps qu’il n’y avait plus de chaussures à vendre ni à acheter. Dans un magasin, on me sortit une paire de bottines qu’on n’avait pu vendre tant elles étaient vieilles. C’étaient de celles qui montaient un peu au-dessus de la cheville, avec leur rangée de petits boutons sur le côté, dont je pense qu’elles étaient plutôt pour femmes. Mon pied y entra, je me les achetai, je ne sais combien je les payai. Pendant une guerre, de nombreuses choses qu’en temps ordinaire on met de côté ou qu’on jette redeviennent bonnes, et on en est bien content.
Huit jours à marcher au pas, ne mangeant pas très bien. La situation était critique en la matière. Au moins, c’était chaud. Après ces huit jours de formation, on nous fait monter dans des camions GMC et Katiouchas, direction la zone frontalière d’Andorre, près de la Seu d’Urgel, à huit kilomètres. On nous fait descendre et les camions s’en vont. Nous, au bord de la route, on devait venir nous chercher pour nous intégrer à notre unité définitive. Nous voilà à attendre, le jour baissant, faisant quelques pas par-ci par-là, attendant toujours que quelqu’un vienne. Ce qui vint, ce fut la nuit. Voyant que personne ne savait rien ni ne venait, certains commencèrent à s’asseoir dans l’herbe en manifestant leur mécontentement de notre abandon. Nous finîmes tous par nous étendre par terre. Nous nous couvrîmes avec le peu que nous avions, et passâmes la nuit au bord de la route. C’est que nous étions épuisés par tout ce temps passé dans les camions, à pied, et à attendre. Quand je me réveillai, je me rendis compte que l’herbe avait gelé pendant la nuit, et par conséquent nous aussi. Ce souvenir ancré dans mon cerveau est véridique. La preuve est que je l’écris encore aujourd’hui.
Vers les neuf heures du matin arrivèrent des officiers avec leurs casquettes et leurs galons rutilants. Ils n’avaient pas dormi au bord de la route sous la gelée. Eux étaient bien reposés, et nous affamés et bien frigorifiés. Ils nous rassemblèrent. Nous étions approximativement une centaine. Ils nous dirent, entre autres choses, qu’à partir de cet instant nous appartenions à la 34ème division. Son chef Trueba, Vicente [2] je crois, communiste, était dangereux pour ceux qui ne pensaient pas comme lui. Plus tard, on nous envoya à la 104ème brigade, et le jour suivant au 15ème bataillon, 2ème compagnie, et enfin la 2èmesection.
Nous arrivâmes 34 recrues dans cette compagnie, parmi des classes de tous âges ; nous étions de la plus jeune. Chaque groupe fut choisi par les sergents des compagnies respectives. Nous nous mîmes en marche au pied des Pyrénées vers l’ouest en laissant derrière nous la Seu d’Urgell et Andorre. Comme il n’y avait pas de route, nous prîmes les sentiers muletiers. Nous marchâmes plusieurs heures. Enfin, ils nous firent camper sons une pinède, pas très loin de Tremp, localité importante par sa centrale électrique mais aux mains des franquistes.
Un jour que j’étais en train de parler avec Agostinet, un lieutenant vint à nous et nous demanda de l’accompagner pour prendre contact avec les officiers d’une compagnie voisine appartenant à une autre division. On trouva lesdits officiers et l’un des deux était de notre village. Nous le reconnûmes tout de suite, vu qu’à Alcarràs tout le monde le connaissait, le Tonet de Samion. Il fit semblant de ne pas nous connaître. Et quand nous en parlions avec Agostinet, nous n’en revenions pas.
Nous-nous reposâmes douze jours dans cette pinède, et vint l’ordre que l’on devait prendre le mont de San Cornelio. Au sommet de cette montagne, à ce qu’il paraît, il y avait une espèce d’ermitage d’où on dominait Tremp. Nous devions le prendre à revers. Après quelques explications de nos chefs, et avoir reçu munitions et conseils, à la fin de l’après-midi d’un jour du début du mois de mai, et dans la province de Lérida où je suis né, ils firent mettre en file indienne les deux compagnies en direction de la vallée. Tous ensemble, nous marchâmes toute la nuit en suivant un petit filet d’eau qui disparut, avalé par la terre. Je ne sais pas si les calculs de ceux qui ont planifié l’attaque étaient bons ou si la nuit fut courte, mais le fait est que lorsque nous sortîmes de la vallée le soleil sortait aussi. Et en face de nous, sur le plat, il y avait un petit village où les forces franquistes étaient postées et sur leurs gardes, et commencèrent à nous tirer dessus dès qu’elles nous virent. Ceux qui étaient devant tombèrent. La deuxième section était la nôtre, et face aux mitrailleuses mon réflexe instantané fut de quitter la file que nous formions, attendant une balle qui n’arriva pas. En me séparant et en m’éloignant du groupe, j’entendais les mitrailleuses qui tiraient sans cesse.
Le Gostinet ne m’avait pas suivi. Dans ces moments-là, je crois que l’instinct de survie fait que chacun a sa manière de réagir. Je n’étais plus à la vue de l’ennemi. Je pensai à mon ami. Mais en marchant parmi les pins et les broussailles en terrain ennemi, j’étais seul. Aucun des miens ne m’avait suivi. Ma situation était très compromise. Je n’avançais pas beaucoup, à mi-hauteur entre le pied de San Cornelio et le sommet. Je crois que dans cette zone les franquistes n’avaient pas une ligne de front mais seulement des positions stratégiques : dans ce petit village au-dessus de San Cornelio, et à Tremp, base du secteur. Avec effort, j’avançais du mieux que je pouvais. Le soleil commençait à chauffer. Sans boisson ni nourriture, fusil et balles à l’épaule je pensais à ce qui était arrivé, mais mon imagination était loin, très loin de la réalité. Je maintenais toujours ma marche à mi-hauteur, la gorge sèche et l’estomac plus que vide mais sans découragement, et en avant. Dans ces cas-là, on pense à ce à quoi on tient le plus. En premier lieu à ma propre vie, puis à ma mère, mon grand-père et ma petite sœur (je ne savais pas où était mon frère avec son unité), et à mes camarades de la compagnie. Je marchais au milieu de ce maquis d’arbustes, de branches, de pins et de broussailles où il est difficile d’avancer.
Mon défunt père ne portait pas de montre de son vivant, mais il avait son système pour savoir quand approchait midi. Il se mettait face au soleil, la paume de sa main à plat et il levait le doigt le plus long. Si l’ombre arrivait au milieu de la main, il était midi, heure solaire. Moi, je m’arrêtai au milieu de ce maquis, constamment en alerte et regardant de toutes parts, et j’utilisai la montre solaire de mon père. Et je me dis qu’il était plus de midi : il devait être entre une et deux heures de l’après-midi. Cela faisait de longues heures que je marchais, depuis la veille au soir jusqu’alors sans fléchir. Je me remis en marche et le soleil était très chaud. Je ne sentais plus que la nécessité de boire.
Quelle ne fut pas ma surprise quand je vis la partie haute de trois soldats qui marchaient dans une direction complètement contraire à la mienne. Eux aussi me virent, mais aussitôt eux comme moi fîmes comme si nous ne nous étions pas vus. Je compris qu’ils descendaient de la position que nous devions prendre au-dessus de San Cornelio. Je ne sais pas ce qu’ils pensèrent de moi, mais certainement rien de bon. Ils prenaient la direction de la base de Tremp. Je changeai un peu ma propre direction pour m’éloigner d’eux, si bien qu’ils descendaient pendant que je me mis à monter droit devant. Ils finirent par comprendre que je n’étais pas des leurs. Il m’est difficile d’estimer la distance entre eux et moi, mais le fait est qu’ils se mirent à me tirer dessus d’au moins 250 mètres à coups de fusils. La montagne à cet endroit était très pentue et le sol fait d’éboulis avec des arbustes de buis épais. Je courais vers le sommet pour m’éloigner encore d’eux, mais dans la pente et dans les pierres, quand j’avais fait sept ou huit mètres je me laissais tomber à terre pour récupérer. Quand j’étais au sol ils ne pouvaient pas me voir, les arbustes me protégeaient, et je voyais tomber les petites branches coupées par les balles. Ce calvaire dura quelques vingt minutes, en ces circonstances le temps ne compte pas. Je ne sais pas ce qu’ils conclurent, mais ils arrêtèrent de tirer. Peut-être que ne me voyant plus ils pensèrent je ne sais quoi, mais moi, par chance leurs balles ne m’avaient pas touché. S’ils m’avaient infligé une mauvaise blessure, il est certain que dans ces parages sauvages personne ne serait venu me chercher et je serais mort là comme un sanglier sans même pouvoir ramper.
Le feu ne venait plus des fusils fascistes, mais il venait du soleil et de mon corps. Je me reposai un moment. Lors de ces vingt minutes-là, j’avais fini de transpirer le peu d’eau que mon corps possédait. Je continuais plus tranquillement mais toujours en alerte, le fusil à l’épaule, en montant vers l’est où je croyais que se trouvaient mes lignes, lorsque se présenta à mes yeux un rocher de quelques huit mètres de haut duquel tombaient quelques gouttes d’eau éparses. À ma grande surprise, c’était de l’eau fraîche et pure. J’étais déjà sous une gouttière, bouche ouverte comme une carpe, puis j’essayai avec les deux mains jointes. Se passa ainsi un bon moment. Ayant bu, je sentis la fatigue. Ma poitrine était trempée. Je me lavai et m’assis. Rien à manger, mais j’avais plus ou moins bu, et je crois que cinq minutes plus tard je dormais déjà à la fraîcheur de cette muraille de pierre bienfaisante.
Je ne sais pas combien de temps je dormis, le fusil serré entre bras et jambes, mais si quelqu’un était arrivé mon compte aurait été bon. Ma chemise était de nouveau sèche et le soleil baissait. Je pensai à mon ami Gostinet, me demandant où il pouvait être, et lui de même. Je me levai, cherchai à boire encore un peu, m’orientai et me dis que mes lignes étaient à l’est. De fait, j’avais déjà fini de faire le tour du mamelon de San Cornelio. Je n’étais plus très loin des miens, progressant toujours avec grande précaution, mon fusil dans les mains. Le soleil se couchait. Les compagnons qui s’étaient sortis de cette tuerie ne croyaient plus qu’il puisse encore arriver quelqu’un. Je me déplaçais d’un arbre à l’autre, à demi caché. Enfin, je vis un homme. Il était environ à deux cents mètres. Je n’étais pas certain qu’il fût des nôtres. La position dans laquelle se trouvait cet homme était la suivante : son pied droit à terre, l’autre un peu plus haut sur une pierre, à moitié penché, avec le coude sur le genou de la jambe levée, et sa main dans laquelle sa joue reposait. Je m’approchai encore, personne ne montait la garde. Personne n’attendait plus personne. Enfin, cet homme qui était dans la position décrite était mon ami Gostinet ! Je pus m’approcher tant que je me rendis compte du triste qu’il était sans espoir de me revoir. Son regard allait dans le vague, sans but. Sa pensée occupait tout son être : lui sans espoir de me revoir, et moi plein de la joie de l’avoir reconnu. Après m’être assuré que c’était bien lui, je sortis de ma demi-cachette. Il fut le premier à me voir, des cinq qui étaient ensemble, et il cria : « Un autre, un autre ! » Ils coururent tous vers moi. Mon ami arriva le premier et nous nous prîmes dans nos bras sans pouvoir dire un mot pendant un long moment. Et au milieu de la joie des six, joie immense, intense, je ne pensais à rien : ni à la chaleur de cette journée, ni aux balles des soldats, ni à la soif ni à la faim, à rien d’autre qu’à la joie. Laquelle dura des heures.
Lorsque nous fûmes calmés, nous parlâmes des heures durant de ce qui s’était passé ce 25 mai 1938. J’aurais pu mourir plusieurs fois. La mort ne voulut pas de moi, ce n’était pas mon jour. C’était vraiment une trop belle journée pour mourir. Oui, c’est vrai, ce fut un jour de grande chaleur sans un nuage. Mais par malheur, la beauté de cette journée n’empêcha pas que, des trente-quatre recrues arrivées à la compagnie, nous ne fûmes que quatre à nous en sortir parmi ceux de dix-huit ans de la classe biberon et des classes des aînés. Deux de Barcelone et deux d’Alcarràs.
Après la tentative d’infiltration pour prendre San Cornelio à revers, nous ne pûmes pas attaquer puisque nous avions nous-mêmes été attaqués. Au vu des pertes que nous avions subies, ils réunirent les restes des deux compagnies et, sac au dos et à pied, nous marchâmes au moins quatre heures vers l’arrière et nous rejoignîmes le bord d’une route. Ils nous firent camper là pendant cinq jours à ciel ouvert, sous la pluie, trempés jusqu’à la moelle. Il y avait de quoi tomber cent fois malades.
Arrivèrent des camions découverts dans lesquels nous montâmes. C’est là qu’un soldat resta. Il cria pendant des heures. Certains disaient qu’il avait une hernie étranglée. Je n’ai jamais su si l’ambulance était venue le chercher, mais j’ai encore mal au cœur d’entendre ses cris résonner dans ces vallées et ces montagnes.
Nous voilà dans les camions, sur la côte qui s’appelle Bóixols, direction inconnue. Nous en descendons pas très loin de la Seu d’Urgell et près d’Andorre. On nous fait mettre en formation et on nous distribue du pain et une boîte de sardines. Nous marchons par un sentier muletier, l’un derrière l’autre vers les sommets, montant progressivement pour arriver enfin dans un village vidé de ses habitants du nom de Tavascan. Selon la rumeur, la majorité des gens s’en était allée en Andorre ou en France. Quelques-uns étaient mobilisés avec nous. À Tavascan, nous avions un Poste de Commandement composé d’un lieutenant et de sous-officiers. Nous montions la garde à tour de rôle. Nous mangions peu mais régulièrement. C’était mieux que certains jours passés... C’est dans ce petit village des confins pyrénéens que je vis un jour macérer de la viande crue dans un grand plat d’oignons et d’herbes. Je demandai aux cuisiniers ce que c’était, et ils me répondirent que c’était un chat. Je ne sais pas si c’était la vérité ou un mensonge, mais le jour où ils le firent cuire à la braise, ils me demandèrent si j’en voulais. Et, comme la faim était plus répandue que la nourriture, je leur répondis oui et ils mirent un bon morceau dans mon assiette que je mangeai sans aucune arrière-pensée. Qu’il fût chat ou un autre animal, je le trouvai excellent !
À Tavascan et ses environs, avec de l’eau de toutes parts et par conséquent dans la verdure éternelle, nous étions vraiment tranquilles. Nous ne savions pas où était l’ennemi. Le transport du ravitaillement se faisait entièrement à dos d’ânes ou de mules par un sentier étroit qui montait sensiblement. Au réveil, nous allions nous laver à cinquante mètres où, entre les roches, coulait de la neige fondue descendue de plus haut. Je n’avais pas de savon et, pour me sécher, un morceau de guenille plus vite sale que propre. Il n’y avait rien d’autre. Je me rendis compte que j’avais attrapé la gale entre les cuisses. C’était très courant en ces temps de privations. On nous a donné de la pommade à base de soufre pour se laver dans l’eau glacée. Il n’y avait pas d’autre solution ni d’autre remède, et cela cicatrisa. J’en fus bien content.
Un capitaine arriva à Tavascan. Un brave type. Un Valencien. Il avait besoin d’une ordonnance, et comme mon ami Agostinet était petit de taille, il le choisit. Un jour arriva l’ordre de quitter Tavascan en direction de Tirvia, un petit village entre deux lignes espacées de 6 ou 7 kilomètres. Et un matin, avec deux autres camarades, nous descendîmes au village. C’était toujours la même chose pour la nourriture, et dans une étable il y avait trois cochons d’environ 80 kilos. Je dis à mes copains : « Surveillez dehors. Moi, je vais essayer d’en tuer un ! » Chose dite, ils se postèrent chacun à un endroit différent. Moi, j’attrape un solide bout de bois, j’éloigne deux cochons et je reste avec un. Je commence à lui mettre des coups sur le front. Le pauvre, il couinait à chaque coup jusqu’à ce qu’il tombe sur la paille. Encore quelques coups et, comme j’avais toujours sur moi un petit couteau avec une lame qui ne faisait pas 10 centimètres, je le saignai. J’en fis des morceaux en suivant les jointures et on l’emporta. Nous fîmes des heureux à la compagnie, mais il nous tardait d’abandonner les lieux ! [3]
On resta au-dessus de Tirvia une quinzaine de jours et on nous fit prendre à nouveau les chemins étroits de montagne pleins de cailloux et de racines d’arbres en forme de marches. Et, toujours vers les hautes Pyrénées, nous arrivâmes à Alins. En chemin, comme d’autres de la compagnie réduite, nous avions arraché une betterave ou deux, selon la taille. Des betteraves à vaches, même pas sucrées. Rien ne nous faisait mal, rien ne nous donnait la colique !
Bien entendu, dans toutes les montagnes du monde, il y a des points bas et des cimes importantes, tellement qu’en haut de l’une d’elles mon ami Agostinet ne put plus avancer. Il manquait d’air. C’est vrai que nous avions tout le barda du soldat en campagne : le fusil, les munitions, un sac à dos ou au côté, deux gourdes et une ou deux couvertures. Le tout ne valait pas trois sous. Un ramasseur de guenilles ne les aurait pas prises. J’ai souligné à plusieurs reprises que nous étions dans les hautes Pyrénées, mais je n’ai pas dit un mot sur l’équipement spécial qui est nécessaire dans les zones de montagne de 2 à 3000 mètres d’altitude. C’est le cas du pic d’Aneto, 3404 mètres, et nous étions dans cette zone. Là, ce fut la fin des chemins de chèvres et de moutons. Mal chaussés, très mal habillés. L’équipement de montagne ? On ne savait pas si ça existait. Nous arrivâmes en été, c’était bien. Pas d’ennemi à l’horizon, mais nous montions. Nous commençâmes les tours de garde de nuit. Pas une chèvre, ni un mouton : rien à manger. Mais nous avions de la bonne eau car, un peu en contrebas, la nature avait fait un lac d’environ cinq cents mètres carrés où nous pouvions nous laver et laver notre linge plus que sale et sans savon. Les jours passaient et le ravitaillement qui nous était destiné, plus d’une fois, n’arriva pas. Le mulet ou l’âne, faibles comme ils étaient de ne pas manger non plus, étaient plus ou moins chargés et avaient fait je ne sais combien de kilomètres pour arriver à notre position. Ils étaient le plus souvent à bout de souffle et plus que fatigués. Il arrivait qu’ils trébuchent et tout finissait sa course au fond du ravin, bête et ravitaillement. Et nous, nous attendions. Plus tard, on nous fit aller chercher à une dizaine de kilomètres le ravitaillement qui nous était destiné, à dos d’hommes. C’est-à-dire sur notre dos.
En attendant, au poste, bien plus bas, il y avait le capitaine, les lieutenants, un sergent et l’ordonnance du capitaine. Ils formèrent une section spéciale de réserve de quinze hommes. Moi, je me trouvais dans la position la plus haute, et nous avions trouvé une sorte d’igloo construit certainement par un gardien de moutons. Cet igloo était bâti en pierres sèches et plates. D’une largeur d’à peu près un mètre à l’intérieur, on y dormait à trois camarades. Il est vrai que la graisse était loin de nous encombrer, mais pour dormir il fallait se mettre tous les trois sur le côté. Malgré les joints des pierres et le froid de la nuit, et grâce à nos couvertures, nous n’avions pas froid et malgré la faim nous dormions comme des bienheureux.
L’été et l’automne étaient passés. À partir d’une certaine hauteur dans les montagnes, il n’y a plus de végétation et donc pas de bois pour se chauffer tout au long de l’hiver, mis à part quelques bouts de genévriers couverts de neige. Lorsqu’il neigeait la nuit et que le vent soufflait, la neige pénétrait dans notre igloo mais il y faisait tellement chaud qu’elle fondait. Et quand il cessait de neiger, le vent l’emportait dans la vallée. Cela, c’était l’hiver 1937-38. Et là-haut, l’ennui et les privations avaient créé une mauvaise humeur parmi nous. Nous nous disions malgré cela que là où nous étions, nous ne risquions rien. Et voilà que les forces républicaines engagent la fameuse bataille de l’Èbre. Voilà aussi la relève qui arrive. C’était des carabiniers, et dès la première nuit, ils passèrent à l’ennemi, et on n’a plus jamais eu de nouvelles... Nous qui n’étions plus très loin, on nous fit rebrousser chemin vers où nous étions dans les hautes montagnes.
La bataille de l’Èbre : les forces républicaines y laissèrent le peu de réserves que l’armée possédait. Il y mourut beaucoup de nos soldats, et lorsque l’on nous relevait, c’était pour aller à l’Èbre. Nous ne pouvions que remercier les carabiniers d’avoir déserté, car comme ça, nous ne risquâmes pas notre vie à cette bataille.
Je savais les conditions de vie en hiver en altitude. Ce qui fait que quand je vis mon ami l’ordonnance du capitaine, Agostinet, je lui dis : « Pourquoi ne demanderais-tu pas au capitaine Vidal de Dios de m’intégrer à la section spéciale ? » Et ainsi fut fait. Un jour, on m’ordonna de descendre au poste. Là, j’étais mieux, plus à l’abri, et je mangeais régulièrement.
C’était l’automne 1938. L’hiver nous faisait peur par la rudesse du climat, les privations et le manque d’abri, de vêtements et de souliers appropriés. Au début de l’hiver, il tomba environ quatre-vingt centimètres de neige. Pas un brin de vent, et température très très basse. Les camarades qui étaient en haut de la position descendirent. Il y en avait qui pleuraient. On nous avait donné l’ordre, à nous la section spéciale, de leur porter secours. Nous, nous avions chaud en montant dans de la neige à ne pas pouvoir avancer. Eux descendaient. On trouva là-haut, dans un igloo comme celui que j’avais habité avant, le lieutenant Vitoria plié en deux dans une couverture. Il attendait l’ordre de se retirer. Nous lui apportâmes l’ordre. En réalité, nous n’avions pas d’ordre écrit, mais nous le convainquîmes d’abandonner et de descendre. Ce qu’il fit. Et rien ne lui arriva.
Nous abandonnâmes ces lieux éloignés de la route au cœur des montagnes, et nous commençâmes à descendre, fusil et barda sur les épaules par étapes vers les contreforts des Pyrénées. Là, repos d’une dizaine de jours dans la pinède. Par là, pas loin, il y avait une position ennemie, qu’on appelait Piedras de Aolo, que nos troupes avaient essayé de prendre à plusieurs reprises dans le but de rentrer en contact avec nos forces isolées à Boltaña et en Aragon. Mais ces troupes avaient la possibilité de passer en France.
Tant que nous étions dans cette pinède, comme il y avait d’autres petites unités, on essayait toujours de retrouver quelqu’un du même village. Et je rencontrai un de mes cousins germains, Jusep Llados Ribes, ainsi qu’un autre voisin dont je ne me rappelle plus le nom. Ils étaient très mal en point, sans moral, abattus et tristes car ils avaient déjà attaqué Piedras de Aolo deux jours plus tôt. Ils s’en étaient sortis mais se trouvaient sous le choc du danger qu’ils avaient encouru. On parla un long moment et on se quitta en se demandant si on s’en sortirait. Ils s’en sortirent aussi bien que moi.
Je les quittai et arrivai à ma compagnie où on m’apprit que, pendant la nuit qui arrivait, on allait attaquer cette fameuse position qui avait coûté pas mal de morts parmi les nôtres. Voilà ce qu’ils me donnèrent : quatre bombes à main offensives, quelques munitions et une paire de pinces pour couper les barbelés. À plusieurs reprises, ce petit mamelon n’avait pas été pris et nous avions peur d’échouer aussi. Tout était prêt pour l’attaque et, tout à coup, contrordre : on n’attaquait plus car lesdites troupes se trouvant à Boltaña en Aragon étaient passées en France. Le soulagement fut grand !
Les troupes franquistes avançaient toujours et de Piedras d’Aolo nous descendîmes vers la plaine. Là, on était souvent en contact avec l’ennemi en pleine campagne ou en plein champ. Et les fascistes attaquèrent. Nous étions déployés en ligne de front sans aucune protection. Les balles pleuvaient de partout. Moi, je cherchais à voir l’ennemi : rien que des balles et moi au milieu. Lorsque je tournai la tête je ne vis plus personne des nôtres. Je ne restai pas une seconde de plus au milieu des tirs de mitrailleuses et je me mis à courir vers nos arrières. Là encore, la chance avait joué en ma faveur. Je ne souhaite à personne de savoir ce que c’est que d’être entouré de tirs de mitrailleuses. L’instinct de conservation et les réactions qui m’animaient me portaient chance. À partir de ce jour-là, des situations pareilles ne se reproduirent plus. Le capitaine Vidal de Dios reçut une balle en plein front et mon ami Agostinet fut blessé au bras. Après quoi je ne le revis plus et ne sus cela que 23 ans plus tard, à mon premier retour en Espagne. Maintenant, je vois mon ami chaque fois que je vais à notre village d’Alcarràs. Il m’a fait savoir que la position où nous étions, en haute montagne, avec le lac dont j’ai parlé, après construction de la route nécessaire, est maintenant toute bâtie de résidences, lesquelles, à la saison, doivent rapporter gros au grand capital. Et dire que nous luttions pour que les gens aient des logements, et des droits et devoirs à égalité. On en est loin d’un monde comme cela !
Il a été question un moment que nous y allions avec mon ami. Puis nous n’y sommes jamais montés.
Revenons à notre retraite. Toutes nos forces étaient désorganisées. Le ravitaillement, on n’en avait plus depuis belle lurette. Comme les paysans d’alors mettaient leurs pommes de terre en silos en plein champ, on se servait et on les faisait bouillir ou cuire sous la braise quand on avait le temps. On n’était pas talonné, ou alors nous allions plus vite en reculant qu’eux en avançant. Il est vrai que nous étions libres de notre initiative vu que personne ne savait où se trouvait notre commandement. Ni lieutenant, ni capitaine depuis que Vidal de Dios avait été tué. Nous reculions tranquillement, le fusil et la musette sur le dos. Au bout de quelques jours réapparurent nos supérieurs qui reformèrent la compagnie avec ceux qu’ils trouvèrent d’entre nous. Ils nous établirent une ligne. Je me rappelle qu’on s’était assis derrière un petit rocher, face à l’ouest d’où venaient les fascistes. Je me trouvais à côté d’un Valencien, un des rares qui restaient de l’origine de la compagnie. Et tout d’un coup, sa tête tomba sur sa poitrine. Il venait de recevoir une balle dans la tête, tué net. Je me demande aujourd’hui encore d’où est venue cette balle. L’ennemi, on ne le voyait pas. On savait seulement dans quelle direction il se trouvait. Je me demande encore aussi si cette balle était pour lui ou pour moi, vu qu’ils savaient peut-être que je n’étais pas des Rabassaires comme je l’avais déclaré lors de mon incorporation. Ce n’est qu’une hypothèse. Ce copain s’appelait Gonzalvo.
Nous reculions toujours, si bien que de temps en temps, quand on voyait les soldats ennemis, on décrochait.[4] On était plus ou moins organisé en compagnies dans notre secteur. Lorsque les Nationalistes se mettaient à avancer, ils arrosaient parfois le terrain avec des mitrailleuses et le désordre revenait dans nos lignes à chaque mouvement de recul. Devant le village catalan appelé Gironella, il y a une grande plaine avec par-ci par-là des touffes d’arbres. Nous étions un petit groupe de cinq livrés à nous-mêmes. Nous dûmes nous allonger par terre dans un bosquet. Les fascistes tiraient un peu partout et, par malheur, un des cinq reçut une balle dans les reins. Je ne pense pas qu’on l’ait ramassé, car il mourut tout de suite. Nous continuâmes à reculer dès que le tir de l’ennemi se calmait en profitant de tout ce qui pouvait nous cacher à sa vue.
Lorsqu’une armée est en déroute, aucun service ne marche. C’est le désordre, la pagaille, le chacun pour soi. Tout un chacun est livré à lui-même. C’est comme cela qu’arrivent les pillages pendant les retraites.
Un peu plus tard, nous n’étions plus que trois du groupe des cinq dans ce secteur. Un mort et un autre qui avait suivi une direction différente. Nous étions aussi miséreux les uns que les autres mais toujours avec le fusil et quelques cartouches. Quelquefois on marchait, mais d’autres fois on courait à toutes jambes, et voilà que l’un de nous est blessé juste au-dessus du genou. Il paraît que c’était une balle « dum-dum ». Ces balles, qui doivent malheureusement encore exister, ont la particularité de faire à l’entrée de la blessure un petit trou d’un centimètre mais à la sortie un trou de six. Ce copain, nous le transportâmes sur notre dos car l’os et la chair de sa jambe cassée étaient tout éclatés. Lui, je crois qu’il a eu de la chance car nous n’étions pas talonnés par l’ennemi cet après-midi-là et une ambulance l’emporta.
Gironella, on l’avait perdu de vue depuis pas mal de jours. Toujours dans cette plaine, on se rendit compte qu’on approchait d’une autre agglomération. On y arriva le lendemain : Berga, jolie petite ville plus ou moins balnéaire, où les patrons de Lérida, que ma tante Francisquette servait, allaient passer les vacances d’été avant la guerre. Mais lorsque j’y suis passé, c’était comme toutes les villes traversées par des troupes en déroute : des soldats à nous allant dans toutes les directions, sans but bien précis à part celui de ne pas se laisser faire prisonnier.
Il nous arrivait de rester quelques jours sans bouger, alors le commandement réapparaissait et il essayait de réorganiser un peu ceux que nous restions. On se reposait car l’ennemi était en mouvement dans d’autres parties du front. Alors on s’occupait de savoir si on trouvait quelque chose à manger, on essayait de se laver même sans rien pour se sécher. La misère était grande et le moral au plus bas. Dès que l’on se mettait en mouvement de recul, si ça pressait un peu, la plupart des gradés, de l’adjudant au plus haut, disparaissaient comme par enchantement pour réapparaître lorsque le moment leur était propice. Ça fait que, de loin, ils avaient toujours la mainmise et les yeux sur nous. Le commandement, qui avait les moyens de transport et le ravitaillement, était toujours organisé. Où se trouvaient ses troupes, c’était de l’à-peu-près. Alors, comme je l’ai déjà dit, nous prenions des initiatives en son absence avec toujours comme objectif de ne pas tomber prisonniers. Plus d’un resta caché quelque part en attendant les troupes franquistes. Et on ne peut pas les blâmer s’ils ne risquaient rien, c’est-à-dire s’ils ne s’étaient compromis en rien d’autre que d’être mobilisés dans l’armée républicaine.
Et un jour du début de janvier 1939, on était en train de se reposer et peut-être de faire la chasse aux parasites que nous transportions, je vis arriver un homme de mon village que l’on appelait Ros dels Matges. Ce copain, plus vieux que moi de quinze ans, devait avoir environ 35 ans. Il était marié et je crois qu’il avait au moins un enfant. On lui avait dit que par là, il y en avait un d’Alcarràs, et il me trouva. Jamais je n’avais vu un homme démoralisé comme lui. Il me demanda ce qu’on allait faire, ce que ça allait donner, ce qu’on allait devenir. J’ai essayé de lui remonter le moral en lui disant que nous nous dirigions vers la France, que la France était un pays républicain, que nous serions bien reçus et que l’on verrait après. Je n’ai jamais plus eu de ses nouvelles. Trois hypothèses : ou il fut tué pendant la retraite - ce que je ne crois pas trop car il était affecté au corps du train et par conséquent un peu en arrière des lignes de feu -, ou bien il resta caché et fut fait prisonnier, ou bien il passa en France et - de voir comment nous étions traités au début - il rentra en Espagne. Et là, comme il faisait partie des progressistes avant la guerre, et ensuite de la Confédération Nationale du Travail (C.N.T.), il n’en fallait pas plus pour que Franco fasse fusiller un homme. Sa veuve m’attendit 23 ans pour m’interroger sur lui, vu qu’à Alcarràs on savait que j’étais probablement le dernier à l’avoir vu et à lui avoir parlé.
Berga bien dépassée en reculant, ainsi que la plaine qui la précède, voici Vilada. Ce petit village fut laissé aussi à l’ennemi qui occupaittranquillement le terrain que nous abandonnions par la force des armes. Nousnousdirigions vers la coquette cité de Ripoll ancrée au pied des Pyrénées et baignée par une petite rivière du nom de Ter. Ripoll était une cité importante aux abords des Pyrénées. La troupe était dans un état lamentable. Et j’en faisais partie, de cette troupe d’affamés mal habillés, mal chaussés, sans rien pour se changer et pleins de misères. Le ravitaillement, il y avait longtemps qu’il n’existait plus pour nous. Même plus de munitions. Rien. Depuis avant Berga, nous n’avions pas eu de contact avec les troupes qui nous poursuivaient.
Je me repens encore aujourd’hui de ce que je vais relater dans ce qui va suivre. Comme vous l’avez lu plus haut, notre misère, il y avait des semaines qu’elle était au comble. Et plus que cela, elle était indescriptible et le moral se trouvait dans le camp ennemi. Une grande partie de Ripoll était faite de grosses maisons bourgeoises. Je n’aimais pas entrer dans une maison apparemment vide, et pendant toute la retraite, malgré mon état, je n’étais entré dans aucune. Mais là, je me suis décidé tout seul, car il y avait des jours que l’on naviguait chacun pour soi ou par petits groupes. Chacun était libre et sans contrainte des officiers que l’on ne voyait pas. J’entre donc dans une maison bourgeoise avec l’idée de changer de linge, car j’en avais plus que grand besoin. Je n’ai pas fracturé la porte, elle était ouverte. Je montai au premier, j’ouvris les tiroirs et trouvai des chemises. Je ne me rappelle pas m’être changé sur le champ, non. J’avais la notion du danger dans lequel je pouvais me trouver sans le savoir. Je pris trois chemises et deux serviettes de toilette. Je n’avais pas de montre, et voilà que j’en vois une sur le marbre d’une cheminée. Je crois qu’avant d’avoir pensé à la prendre, je l’avais déjà dans la poche. Cette montre avec sa chaîne en argent, je l’ai encore en pièces détachées dans mes vieilleries. Je me repens encore de ce fait. La marque de cette jolie montre, c’était Roskof. À cette époque, pour ceux qui pouvaient s’acheter une montre, c’était une Roskof. Ce fut ma première montre.
La peur. Après cette petite mauvaise action, je sentis quelle montait et prenait une certaine proportion. Je pris mon barda avec chemises et serviettes et je sortis en vitesse. Une fois dehors, c’est sûr que je respirai mieux. Je rencontrai quelques copains et ce petit méfait fut vite oublié. Je me changeai dans un coin. J’étais mieux, mais pas pour longtemps.
De Ripoll à Sant Joan de les Abadesses, il y a environ huit kilomètres que nous fîmes tranquillement. L’ennemi n’était plus dans ce secteur car ça lui pressait plus sur d’autres fronts. À Sant Joan, il y a une ligne de chemin de fer qui devait faire Puigcerdà-Barcelone. Et là, en pleine voie, il y avait un train soi-disant plein d’armes qui était en train de brûler. Les soldats du génie, de la même façon qu’ils faisaient un pont sur une rivière, mettaient ici le feu à un train. Et d’une façon imminente, il courait la rumeur qu’ils allaient faire sauter le pont sur le Ter. C’est une petite rivière, mais avec la neige et la pluie de l’hiver, il descendait tout de même de l’eau !
Nous pûmes passer avant que les dinamiteros aient posé leurs charges d’explosifs. C’est ainsi que, par petits groupes désordonnés, passa ce qui restait de notre unité, et des autres, car la pagaille était partout.
On était arrêtés entre Sant Joan et Camprodon, à une quarantaine de kilomètres de la frontière, et tout le monde avait la même idée, car en temps de guerre on ne sait jamais. Il était bien vrai que cela faisait pas mal de jours qu’on ne voyait pas l’ennemi, mais il suffit d’une fois. Cette idée, c’était de ne pas se faire descendre à 40 kilomètres de la France. On était trois camarades et survint un capitaine. Il s’adressa à moi et il me dit : « J’ai besoin d’un caporal ! » Je lui dis que moi, je n’étais pas bon pour commander les autres. Il insista tellement que nous finîmes par crier fort, mais jamais il ne me dit : « C’est un ordre ! », et les choses en restèrent là. À mesure que l’on s’approchait de la frontière, on voyait plus souvent les gradés. Et comme en ces montagnes il n’y avait pas de routes qui passent les cols, les unités se concentraient vers les voies de communication et de passage de la frontière.
Nous quittâmes Camprodon à 15 kilomètres de la frontière. Il y avait au moins deux heures que nous marchions. Les bords de la petite route étaient encombrés de camions, de voitures et de charrettes. Nous vîmes en passant qu’il y avait là de quoi manger, de la farine, de l’huile... Il faisait nuit et on se disait : « Si on pouvait s’arrêter là, on pourrait se faire à manger ! » Là, le bataillon et les compagnies étaient réunis du fait qu’il n’y avait pas d’autre passage. Et tout en continuant d’approcher les quelques maisons de Molló, dernier petit village catalan sur cette petite route, voilà qu’arrive en pleine nuit l’ordre de revenir en arrière, vers là d’où nous venions. Les risques de perdre la vie au combat étaient inexistants. Nous fûmes surpris et contrariés par ce contrordre à 6 km de la frontière française. Avec deux autres copains, nous décidâmes de rester là, entourés du plus grand désordre dû à l’abandon du matériel roulant du fait de la transformation de la route en chemin pastoral. Nous trouvâmes une poêle, de la farine, de l’huile et de l’eau. Nous allumâmes un petit feu et, comme tant d’autres arrivés avant nous, nous nous fîmes une sorte de crêpe sans sucre ni sel que nous mangeâmes en pleine nuit au milieu de ce tas de misère qui nous entourait. Comme éclairage on avait le feu et la lueur des étoiles. Si on n’avait pas bien mangé, pour nous c’était la joie d’avoir garni nos estomacs de choses abandonnées. Et on se posait des questions : « Où donc avait pu aller notre compagnie diminuante ? » Il ne fallait pas la louper à son retour. À peu près deux heures s’étaient écoulées lorsqu’elle remonta du même pas nonchalant, fatiguée, résignée, et même abrutie. Nous nous intégrâmes à la petite unité sans que personne ne nous dise rien. Direction : la prochaine halte avant de passer en France. Nous arrivâmes à une sorte de petite esplanade au nouveau jour, le dernier de notre guerre. Nous mîmes le barda à terre. Le jour pointait sur les Pyrénées. On n’avait pas le cœur à admirer cette beauté naturelle. Chacun s’arrangea pour dormir un maximum du sommeil qu’on peut dire des braves. Mais notre absence de la compagnie avait été signalée et, vers quatorze heures, voilà que se présentent un commissaire, un capitaine et un lieutenant. Ils nous appellent par nos noms, à quoi nous répondons présents, mes deux copains et moi. Ils se mirent à crier qu’une absence de quelque deux heures de l’unité pouvait être considérée comme une désertion, et bien d’autres paroles inacceptables pour cette petite faute après toutes les preuves données de combattants antifascistes. Ils parlèrent même de nous fusiller. Après qu’ils eurent bien crié, le capitaine dit : « Si ça se répète, je vous ferai fusiller ! » Là, moi, je respirai mieux.
Si par malheur on nous avait fusillés, cela aurait été un crime. Car ceux qui me liront, si toutefois il y en a, verront que tout le long de ce récit est un témoignage de fidélité antifasciste. Et si j’avais voulu m’en aller avec les franquistes, même en dormant j’aurais pu les attendre. Les choses en restèrent là. Je condamne la verve de ces officiers que l’on n’avait pas vus depuis au moins deux mois. S’ils avaient fait parvenir à la troupe le minimum de ravitaillement, je n’aurais pas eu si faim, et par conséquent je ne me serais pas absenté deux heures de mon unité. Et à 6 km de la frontière, ces officiers auraient pu penser que tous ceux qui étaient là étaient de fidèles antifascistes.
Quatre heures de l’après-midi. Tout notre barda sur les épaules, en file indienne, nous amorçons la descente vers la France. Les premiers gendarmes nous font déposer les fusils et toutes sortes d’armes. Il y a quelqu’un qui garde son pistolet vu qu’on ne nous fouille pas. Et voilà que se présente la première nuit en terre de France, à quelques encablures à l’ouest de Prats-de-Mollo. Pour nous et pour moi, en plus de ne plus avoir de fusil, les officiers avaient de nouveau disparu, et pour toujours cette fois-ci. À part cela, tout continuait comme avant : rien à manger, temps gris, très bas, pluie et brouillard. Dans un bois, je me suis fait une sorte de cabane avec des branches d’arbre que j’ai cassées. Je mis une vieille couverture par-dessus et, avec le reste, je me suis couché dedans tant bien que mal sur la fougère. Je dormis, évidemment. Cette nuit-là, la première en France, fut la nuit la plus noire de ma vie par la pensée. Depuis sept jours, j’avais dix-neuf ans, vu que mon passage de frontière par le lieu-dit la Preste, je l’avais fait le 13 février 1939 à quatre heures de l’après-midi. Là, sous ces branchages, me vinrent des pensées pour ma famille : ma mère, ma petite sœur, mon grand-père. J’avais envie qu’ils sachent que j’étais en vie. Je me suis demandé ce que j’allais devenir. Ayant comme toile de fond l’inconnu, cet inconnu qui vous chagrine et vous tiraille, fatigué de tant de nuits en Espagne à mal dormir et par toutes ces pensées, je m’endormis.
Le lendemain, on nous fit déplacer, nous transvasant à pied au sud-est de Prats-de-Mollo en contrebas, où coulait une petite rivière dénommée le Tech. On avait au moins de l’eau courante pour nous laver un minimum. Et voilà que le 20 février il tombe de 15 à 20 centimètres de neige. On n’avait pas vraiment besoin de ça. Pour les autorités françaises, je reconnais que c’était difficile d’organiser le ravitaillement de tout ce monde tout le long des Pyrénées. Nous attendions toujours un peu à manger. J’avais quelques pesetas. Au bout de trois fois, le boulanger de Prats-de-Mollo eut raison de mes économies, comme dit la chanson d’Aznavour. Le papier monnaie ayant été dévalorisé, on n’acceptait que quelques séries de billets que, bien entendu, je n’avais pas.
Dans le Tech, on pouvait se laver malgré le froid qu’il faisait. Les plus malins faisaient bouillir leur linge dans des récipients inimaginables, car quand une population vit au rouge de ses besoins les idées fleurissent dans les cerveaux. Pour faire ses besoins corporels, là, c’était un problème. Les autorités n’ayant rien prévu, il y en avait partout. Je préfère ne pas m’étendre sur ce point !
Toujours la neige. J’aime autant vous dire que les mauvaises couvertures que chacun avait, il ne fallait pas les laisser seules, car elles disparaissaient très vite. Alors, pour se tenir un peu plus chaud, on dormait à deux et même à trois, et on était toujours à surveiller. Avec un de ces copains, nous décidâmes de retourner à la frontière pour voir si on trouvait quelques couvertures. Peine perdue. Nous ne rencontrâmes rien de cet ordre.
Maintenant, en plus du froid et de l’humidité, il y avait la boue : un vrai bourbier. Il arrivait aussi que certains officiers et commissaires républicains décident de retourner en Espagne. Si pour leur malheur ça se savait, ils recevaient une sacrée correction de la part de ceux qu’ils avaient commandés. La troupe découvrait alors que ces officiers n’étaient pas de vrais antifascistes.
Un jour, en me promenant dans la boue pour voir si je pouvais trouver quelque chose à croquer, voilà que je trouve par hasard ce commissaire de mon village que Gostinet et moi avions rencontré lors d’une prise de contact entre unités voisines. Il avait fait alors semblant de ne pas nous connaître. Mais là, à Prats-de-Mollo, il était comme moi : sans grade ni képi. Je pus constater qu’au fond de la petite chabola [cabane], il y avait deux ou trois pains ronds militaires. Les officiers regroupés avaient un privilège de la part des autorités françaises. Là, il me reconnut et nous engageâmes la conversation quelques minutes. Il m’en donna quand même un morceau et je l’en remerciai, même si je n’avais rien demandé. Nous nous quittâmes pour nous revoir en novembre 1939. Ce que je raconterai le moment venu.
C’est fou ce que la faim peut faire faire, et dans la vie je ne suis pas de ces hommes qui prennent des décisions rapides. J’avais appris qu’un officier que je connaissais avait gardé son pistolet, un très beau Parabellum, lors de l’entrée en France, car on ne nous fouillait pas. On se mit d’accord pour essayer de le vendre. Je montai sur la route et entrai en contact avec un soldat français qui parlait un peu catalan. Je lui proposai le pistolet sans l’avoir, et il me dit que oui, ça l’intéressait. Je redescendis et expliquai à Francisco Paredes, le propriétaire de l’arme, qui me la confia. Je remontai sur la route où le soldat faisait les cents pas et je la lui fis voir. Il voulut l’inspecter et la regarder de plus près et, alors que je la lui passai, il se mit à crier en français. Je compris qu’il ne voulait pas la payer, et il garda le Parabellum. Heureusement que Paredes crut ce que je lui racontai, ce n’était que la vérité. Ce que l’estomac vide fait faire. Et les camions de pain sur la route étaient investis et les soldats n’en étaient pas maîtres.
[1] Je me souviens du discours du Señor Torres, le jour de l’inauguration du nouveau centre culturel d’Alcarràs, où il parla entre autres choses de « ces syndicats » qui firent rendre gorge aux caciques. Mais il ne cita jamais le nom de « ces syndicats ». Ici, en Catalogne, en ce temps-là c’était la CNT et des hommes, de nombreux hommes comme Durruti.
[2] Manuel, en fait.
[3] Un fait très triste que j’ai oublié de raconter. Avant d’aller en haute montagne, nous nous trouvions dans un tout petit village des Pyrénées nommé Civís, pas loin d’Andorre. J’appris dans l’après-midi qu’on allait fusiller deux garçons. Comme inculpation, soi-disant qu’ils voulaient déserter et passer la frontière d’Andorre. Je courus 300 mètres pour voir ça et je me suis dit : « Jamais plus je ne reverrai ça. » J’ai eu une de ces peines, un de ces regrets... J’étais sombre. Faire un homme coûte vingt ans, le tuer ne prend que quelques secondes. À ce moment de la guerre, je me suis demandé si cette histoire de désertion était véridique, car souvent des personnes et des soldats disparaissaient sous prétexte que c’étaient des agents de Franco, alors qu’en réalité il s’agissait de syndicalistes qui faisaient de l’ombre à la direction communiste aux ordres inconditionnels de Staline. Et c’est pour ce motif que, lorsque nous arrivâmes mon copain et moi à la division de Trueba et qu’ils prirent notre inscription, je dis à l’Agostinet : « Ici, nous ne sommes pas de la CNT. Nous dirons que nous sommes des Rabassaires, une organisation paysanne. » Rien ne nous arriva de ce côté-là.
[4] Nous les Républicains, on nous a appelés les « Rouges ». Et toute la puissante presse internationale appartenant au grand capital ne se gênait pas pour employer ce sobriquet. Les autres, c’étaient les Nationalistes... à titre d’information. Seulement, ce que la presse internationale ne disait pas, c’était que Franco tuait des ouvriers qui voulaient un peu plus de pain pour leurs enfants. Les Républicains tuèrent ceux qui avaient l’estomac bien garni, et cela de génération en génération.