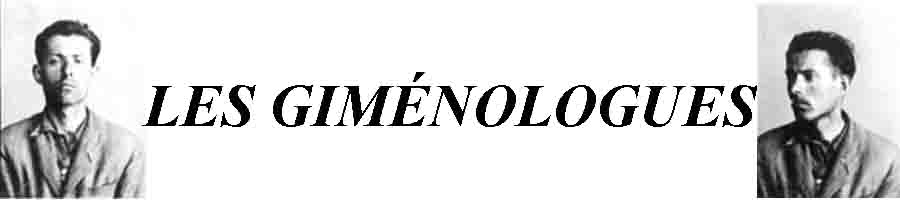« Retours sur mémoire :
Lucia et José »

De 2008 à 2010 nous avons accompagné Jordi Gonzalbo dans ses Itinéraires « non choisis » puis « choisis », depuis sa Barcelone natale jusqu’à sa ville d’adoption : Perpignan [1].
Il nous embarque aujourd’hui dans la Barcelone des années trente et quarante et revient sur l’activité militante de ses parents Lucia et José, grâce notamment à la découverte du volumineux sumarísimo de José Gonzalbo Benedicto [2] aux archives du Tribunal militaire Tercero de Barcelone, où se trouvent les dossiers de toutes les personnes exécutées au Campo de la Bota après une instruction judiciaire accélérée et un jugement sommaire [3]. La trouvaille suivante – des articles de La Vanguardia de 1933 et 1934 – nous a permis d’en savoir plus sur les aléas de l’engagement de José et de Lucia Esteve Vidal avant 1936 [4]. Les Giménologues ont participé au texte qui suit en apportant quelques développements d’ordre historique.
Les Giménologues, le 11 juillet 2011
« RETOURS SUR MEMOIRE
Lucia et José »
Quand on atteint un âge respectable et qu’on est conscient du fait que le futur n’est fait que de lendemains sans avenir, certains éprouvent le besoin de faire un arrêt sur image, de jeter un regard teinté de mélancolie sur ce qu’a été leur cheminement de vie.
Pour quelques-uns c’est juste un aller-retour, rapide bien sûr ; ce qui est fait est fait, donc inutile de se prendre la tête sur ce qui aurait pu, ou dû, être. Le présent est déjà tellement difficile à gérer…
Pour d’autres il en va tout autrement, surtout quand leur enfance a été émaillée d’événements disons hors norme, subis car non choisis. Se raconter devient un besoin (comprendre les pourquoi et les comment) autant qu’un plaisir. D’autant plus que les souvenirs nichés pêle-mêle quelque part dans la tête éprouvent soudainement le besoin de sortir de leur hibernation, insistent, se font pressants.
Tenté mais pas du tout convaincu d’être capable de mener à bien une telle entreprise avec juste le Certificat d’Etudes Primaires en bandoulière, on peut hésiter à sauter le pas. Mais je me suis lancé dans l’aventure il y a déjà quelques années. La raison de cette audace ? Le plaisir de se raconter, l’envie de laisser une trace, de revenir sur une époque disons agitée ; essayer de comprendre, revoir des visages qui ne sont plus, revivre des situations, laisser remonter des ressentis. Les raisons sont multiples. Mélancolie quand tu nous tiens…
À vrai dire ce fut moins ardu que je le craignais. Il suffisait d’ouvrir grand la porte de la cage aux souvenirs pour qu’ils s’égaillent et emportent craintes et hésitations sur leur passage. Le plus difficile fut de mettre de l’ordre, d’élever des garde-fous, d’éviter l’éparpillement et que le témoignage soit cohérent.
Agréablement surpris d’avoir pu apporter ma petite contribution au « devoir de mémoire » [5] (lequel n’est fait que d’une multitude de mémoires individuelles mises bout à bout), je pensais avoir gagné le droit de dormir du sommeil des « justes ». C’était sans compter avec les « pisteurs de mémoire » acharnés à extirper le moindre brin de souvenir encore existant chez les derniers rescapés qui avaient de près ou de loin arpenté le rugueux sol d’Aragon ou d’ailleurs en Espagne [6]. Fouineurs s’il en est, ils trouvent leur plaisir dans le monde si particulier de « l’enfoui », que ce soit dans les têtes ou dans les lieux, salivant au moindre petit bout de papyrus susceptible d’apporter un éclairage nouveau sur tel ou tel événement d’importance. En quelque sorte dérangeants et utiles à la fois car tout nouvel apport d’information inédite implique de revoir certaines parties d’un témoignage forcément incomplet, nourri d’images et de situations perçues par un enfant.
La première partie de mes Itinéraires revenait sur l’époque de mes six ans. En fonction des dernières découvertes, me voilà donc « obligé » de remonter jusqu’à la troisième année de ma naissance. Que ne fait-on pas pour la cause !

« Jordi, Lucia et Montserrat à Barcelone »
De fait je m’étais souvent demandé pourquoi j’avais gardé si peu de souvenirs de l’appartement où je suis né en 1930, sis au 27 de la calle Jaime Giralt, dans le Casco Antiguo, et où j’étais censé avoir habité pendant quelques années. La réponse est toute simple et d’importance.
Selon La Vanguardia du 20 décembre 1933, le jeune José Mariño Corballada fut arrêté par la police porteur d’un sac de toile contenant quatre bombes et plusieurs cartouches de dynamite, au moment où il sortait de la maison située au 27 de la rue Jaime Giralt, premier étage, première porte. Mes parents furent accusés d’avoir gardé chez eux ce matériel détonnant.
Si José Gonzalbo – surnommé « Pep de la Figaira » selon l’auteur de l’article de La Vanguardia – n’était pas connu des services de police, Lucia avait déjà fourni la matière à un rapport sur elle : « Lucia Esteve Vidal est très connue de la police pour fréquenter assidûment les centres anarchistes et se dédier à des activités en faveur des prisonniers, à vendre les journaux anarchistes et syndicalistes quand les libertaires organisent des séances publiques. » [7] On apprend ensuite que la calle Giralt était surveillée par la police et que José Gonzalbo était membre d’un Ateneo rationaliste de Barcelone [8]. Il est précisé que ni Lucia ni José ne reconnaissent les faits dont on les accuse.
Je pense que Lucia était au courant, mais pas forcément son mari.
Mariño quant à lui demeura toujours muet sur la provenance du matériel ; il affirma ne pas connaître le couple et n’admit que ses convictions anarchistes. Selon le rédacteur de l’article il avait déjà été arrêté pendant les grèves et insurrections de 1933 [9], mais il avait été laissé en liberté faute de charges et du fait de son jeune âge (19 ans) ; et peut-être aussi parce qu’il était issu « d’une honnête famille vivant depuis longtemps à Barcelone déplorant l’idéologie de son héritier dont elle n’a pu le détourner malgré ses efforts » [10].
En dépit de leurs dénégations, les trois compères furent emprisonnés jusqu’au jugement. Le tribunal condamna Mariño à six mois de prison et les époux Gonzalbo à deux ans chacun en janvier 1934 [11].
Ce n’est que bien plus tard que j’eus connaissance de ces arrestations mais pas de leur importance. En fait, en fonction des informations trouvées dans La Vanguardia, j’ai pris la mesure de la situation peu ordinaire qu’ils vécurent, surtout ma mère.
Il est évident qu’à cette époque les couples qui menaient de front travail à l’usine [12] et militantisme devaient souvent faire des choix difficiles, et certains lourds de conséquences. Mes parents travaillaient pour vivre, militaient pour faire la révolution et jonglaient avec leur « temps libre » pour s’occuper au mieux de leurs enfants, Montserrat, née en 1927, et moi-même, né en 1930. Je suis persuadé que ce qui leur permettait de garder la tête hors de l’eau c’était l’entraide et la solidarité, mots qui à leur époque avaient un sens.
Cette solidarité avait pour moi un visage, celui d’une personne d’âge moyen, que nous appelions affectueusement la dida, Fernanda Vila.

Elle appréciait mes parents, particulièrement ma mère ; aussi quand ils avaient des problèmes elle me prenait chez elle le temps qu’il fallait. Fernanda habitait le même quartier que nous avec son mari et leur fils Fernando âgé d’une vingtaine d’années.
Elle m’a donc recueilli chez elle lors des arrestations. Ma mère, je la voyais de temps à autre, sans trop me poser de questions, mais il est certain que je n’habitais pas avec elle, et pour cause...
La Vanguardia du 27 février 1934 titrait cette fois en page 12 : « Evasion de la prison de femmes. Deux prisonnières condamnées à plusieurs années se font la belle ». Les fugueuses étaient Adela Aulestia Mas (condamnée à 24 ans de prison) et Lucia Esteve Vidal. Le plus simplement du monde elles avaient dérobé dans le bureau de la directrice les clefs qui leurs permirent de passer toutes les portes jusqu’à la sortie dans la rue, sans que personne ne les remarquât.
Cela se produisit donc pour Lucia après quelques semaines de détention seulement, et l’on suppose qu’elle trouva à se cacher et à vivre clandestinement grâce au milieu libertaire. C’est dans ces conditions qu’elle vint me visiter de temps à autre chez la dida, et comme celle-ci vivait près de notre rue (calle de los Judíos), il n’y a pas eu de véritable rupture dans mon existence.
Le plus étonnant de l’histoire c’est que ma mère a vécu pendant pratiquement deux ans dans la clandestinité, et que même à la fin de sa vie elle ne m’en a jamais parlé.
Mon père fut emprisonné à la cárcel Modelo. Il eut ensuite le loisir d’apprécier la qualité d’accueil d’un autre lieu de détention : le pénitencier de Chinchilla [13], d’où il s’évada on ne sait pas bien à quelle date : l’évasion était décidément une affaire de famille. Réincarcéré peu après [14], il fut amnistié et libéré après la victoire du Front Populaire aux élections de février 1936.
En février 1936, je ne me souviens pas que nous ayons vécu à nouveau en famille dans l’appartement du 27 de la calle Giralt. Ma sœur Montserrat avait des problèmes respiratoires depuis longtemps et elle fut hospitalisée dans un sanatorium non loin de Barcelone. Je me rappelle d’un bâtiment immense entouré de pins et de montagnes, lors d’une visite qui doit dater de 1933. Après sa sortie du Sanatorium de Tarrasa, les médecins recommandèrent à mes parents d’éloigner Montserrat de la ville. Entre 1933 et 1936, grâce à des amis communs, Francisca Matas Volasell qui ne pouvait avoir d’enfant proposa de garder la convalescente chez elle à Rosas.
Montserrat y resta visiblement jusqu’au départ de Lucia à Perpignan en 1938.
Lucia et José travaillant [15], ils ne pouvaient s’occuper de moi que le dimanche, et dans la semaine j’étais pris en charge par Fernanda.

Et puis survint le coup d’Etat militaire suivi du processus révolutionnaire, intense à Barcelone comme on le sait.
Lucia a raconté à ma fille sur un ton encore exalté les batailles des journées de juillet 1936 à Barcelone ; comment elle et d’autres s’affairaient à soigner les blessés. Elle se souvenait d’un pharmacien auquel il avait fallu arracher du matériel sanitaire des mains car il ne voulait pas le donner à la population.
José et Lucia connaissaient à l’évidence plusieurs responsables de la CNT-FAI catalane, et ils étaient comme chez eux tant au front qu’à Barcelone où ils participaient d’une manière ou d’une autre aux activités de la régional CNT.
Ils sont partis un moment au front d’Aragon dans la colonne Durruti. Lucia a raconté, toujours à ma fille, comment elle laissa le fusil (car à chaque coup tiré sa petite silhouette tombait à la renverse) pour s’occuper des prisonniers (au front ou à Barcelone). Elle m’a dit un jour comment cela lui paraissait paradoxal et gênant pour une anarchiste de se trouver de l’autre côté des barreaux.
Il se trouve que Lucia – qui avait été élevée au couvent – eut à garder des nonnes, et qu’elle s’occupa d’elles avec « charité », ce qui lui valut des marques de reconnaissance de ses dernières. Elle leur répondit sèchement que dans la situation inverse, ce n’aurait pas été le cas, car elle connaissait bien leur mentalité détestable.
Quand les femmes durent quitter le front, selon Lucia, Durruti intervint pour qu’elle restât. Lucia connaissait bien Durruti ; elle m’a raconté qu’elle était allée le visiter en prison, comme le faisaient beaucoup de militantes au sein des Comités Pro presos. Il n’est pas exclu qu’elle soit allée le voir durant sa cavale lors des arrestations d’octobre 1934.
Les époux Gonzalbo faisaient visiblement des allers-retours entre le front et Barcelone, et ils passaient aussi à Rosas voir leur fille chez sa dida.
Selon les dires de Francisca Matas dans sa déposition en 1941 [16] José se déplaçait en Aragon et aussi à Madrid. Lui et Lucia se rendirent en voiture à Rosas voir leur fille en septembre 1936 ; José était armé. Francisca et son mari Miguel Blanch leur demandèrent d’intervenir pour sauver la peau d’un membre de la famille qui s’occupait aussi de Montserrat, Benito Trull Escatllar, arrêté par les patrouilles de contrôle de Rosas. Ma mère le connaissait et estimait que c’était un bourgeois de droite [17] mais pas un fasciste. Par ailleurs si au cours des grèves insurrectionnelles elle avait soutenu les représailles contre des matons ou des hommes de main du patronat, elle n’était pas favorable aux exécutions en période révolutionnaire.
Elle alla à Rosas et convainquit ses copains de libérer Trull. Selon la déposition faite en 1941 par Miguel Blanch, José intervint également auprès du Comité révolutionnaire de Rosas pour que Trull soit transféré à Barcelone et mis sous la responsabilité du Comité régional CNT. Puis il demanda à la personne [Soria ?] avec laquelle il s’était évadé de Chinchilla de le faire libérer.
Par ailleurs en décembre 1936, à la demande de Benito Trull, José contacta Ramona Coll Suquet de Rosas, et entreprit des démarches pour faire libérer son mari Domingo Cusi Trull, cousin germain de Trull.
C’est sans doute à cette période que la relation entre mes parents se disloqua complètement. Lucia, à tort ou à raison, a toujours présenté José comme un militant moins engagé qu’elle, et un peu volage.
J’ai su bien plus tard que vers la fin 1936 ou début de 1937, José avait noué une relation amoureuse avec Aurelia López, une artiste de cabaret. José déclare à la police le 10 février 1941 qu’il « a vécu toute la guerre chez Aurelia López au 44 de la rue de Rosal à Barcelone », et qu’ils eurent une fille ensemble. Il s’agit sans doute de l’enfant de moins de trois ans qui apparaît avec José sur la photo, récupérée aux archives dans le sumario en 2007. Donc j’ai – ou j’ai eu – une demi-sœur.
Ainsi je suppose que Lucia et José vivaient chacun de leur côté déjà en 1936. Je reviendrai plus loin sur les raisons et les conditions de leur séparation.

Le coup d’État militaire, la militance, le front, la Retirada, l’exil, son retour inopiné à Barcelone en octobre 1939, son arrestation et son exécution en octobre 1942 : tous ces événements cumulés firent que je n’ai pratiquement pas connu mon père, excepté les quelques mois d’exil partagés à Perpignan.
Dans mes Itinéraires non choisis, j’écrivais qu’en octobre 1939 « mon père décida de retourner à Barcelone. À vrai dire je ne connaissais pas la vraie raison de son départ. Pendant quelques années j’ai cru – ou voulu croire, je ne sais plus – qu’il allait en Espagne reprendre le combat contre le franquisme. Son arrestation et son exécution me confortèrent dans l’idée que mon père était un héros. (…) En réalité je sus plus tard ce que ma mère me taisait : mon père était retourné en Espagne rejoindre une personne avec qui il avait vécu peu après notre départ de Barcelone ».
Toujours selon « les dernières nouvelles » mon père retourna donc à Barcelone vivre avec la femme dont il avait un enfant. Il fut arrêté en février 1941 [18] pour une sombre histoire de meubles qu’il avait achetés à un tiers. Rien de grave au départ, mais ça le devint. Incroyable mais vrai José n’avait pas pris la précaution de changer d’identité, imprudence qui permit aux policiers de visiter son curriculum vitae en toute facilité.
L’affaire des bombes pour laquelle mes parents furent condamnés en décembre 1933 refit surface ainsi que son évasion de Chinchilla, passif agrémenté, selon le compte rendu de l’instruction, d’actes de terrorisme :
« Il fut condamné et envoyé au pénitencier de Chinchilla pour y purger sa peine ; peu après il s’évada en compagnie de quelques individus ; qu’en une certaine occasion, il remit à un jeune homme un paquet en lui recommandant de le porter à un endroit précis ; ce paquet explosa et le jeune homme fut arrêté et confessa que c’était José GONZALBO qui lui avait donné cinq ou dix pesetas pour porter le paquet à l’endroit indiqué ; qu’il faisait partie d’une bande de malfaiteurs, et que postérieurement il fut arrêté en raison d’actes de terrorisme et de s’être évadé du pénitencier. Il fut libéré lors des élections du Front Populaire le 16 février 1936 [19]. »
Ces présumées activités terroristes auraient forcément eu lieu avant décembre 1933, puisque de cette date à février 1936 il fut logé et blanchi par l’État espagnol [20].
Par contre les accusations portées contre lui pour son activité durant la guerre civile étaient autrement plus graves, bien qu’ubuesques :
« Que lorsque advint le MN (« Mouvement National ») il fut chef des patrouilles de contrôle [21]. Qu’il signa la sentence en tant que délégué du Comité Régional [de la CNT] du général GODED (chef militaire de la place de Barcelone). Qu’il fut organisateur des colonnes rouges volontaires pour le front ; qu’il fut délégué de la FAI au comité de censure à la prison Modelo de cette cité. Qu’il eut un rôle important au sein du comité régional CNT-FAI. Qu’il avait une très grande amitié avec EROLES [22], ainsi qu’avec DURRUTI, dont il était l’homme de confiance, et chef en second des colonnes de ce nom, aux fronts d’Aragon et de MADRID. Qu’à la libération de Barcelone il s’enfuit en France. » [23]
Il faut savoir que toutes ces accusations proviennent exclusivement de dépositions (non vérifiées) d’habitants de Rosas faites les 4 et 5 février 1941 : Andres Reda Brunet, qui aurait lu dans la presse de Barcelone que José avait signé avec Miratvilles l’exécution de Goded [24] ; Ramona Coll Suquet dont le mari Domingo Cusi Coll a été arrêté le 19 novembre 1936 par les patrouilles de contrôle de Rosas et sans doute tué par elles, et auprès de laquelle José se serait vanté de détenir l’arme d’un marquis madrilène qu’il aurait assassiné avec sa famille, ce qui semble peu plausible. [25] La police exploita également les dépositions venant de personnes qui ne voulaient pas accabler José : celles de Francisca Matas et de son mari ; celle de Benito Trull que José et Lucia ont sauvé de l’exécution. Trull ne cache pas qu’il soupçonne José de prendre contact avec des familles de droite dont des membres sont emprisonnés pour leur soutirer de l’argent. [26]
Mon père n’était donc pas un simple héros, comme le croyait l’enfant que j’étais, et si l’on prend au sérieux les chefs d’accusation, il était un surhomme doté d’un don d’ubiquité exceptionnel.
Toujours selon le compte rendu de l’instruction, José dit qu’il avait bien fait partie de la CNT [27], comme tant d’autres, et avait travaillé au Comité Régional en tant que chauffeur ; qu’il connaissait Durruti de vue comme tout un chacun, sans plus et qu’il n’avait jamais eu ni exercé les responsabilités qu’on lui attribuait.
Il est curieux comme des souvenirs visuels, tactiles et olfactifs marquent un enfant. Le fait de monter aujourd’hui dans une voiture « sentant le neuf » me ramène un gros tas d’années en arrière quand, assis à côté de mon père, la tête penchée hors de la portière, le visage fouetté par la vitesse, nous roulions quelque part dans Barcelone dans la voiture dont il avait la charge.
Il est évident que la justice franquiste avait taillé à mon père un costume trop large, et je doute qu’il ait exercé les responsabilités avancées. Il est possible que José se soit lui-même donné une importance qu’il n’avait pas dans le Mouvement libertaire.
Il était bien cénétiste mais pas un destacado [28] ; toutefois il avait dû connaître beaucoup d’hommes d’action en prison pendant près de deux ans. Il prétend dans sa déclaration – et c’est de bonne guerre – ne pas connaître les nommés Escorza et Eroles, qui étaient des personnalités marquantes au sein du comité régional, en charge de « l’investigation » [29]. Pourtant dans une lettre écrite à ma mère le 26 octobre 1938, José faisait allusion à l’ingratitude de ces camarades « Oliver [30], Pasques [sic] [31], Ezcorza [sic] » avec lesquels il avait tellement travaillé.
En outre, Benito Trull de Rosas déclare dans sa déposition qu’après son arrestation le 26 septembre 1936 il fut visité par José et Lucia qui lui dirent que des démarches étaient entreprises auprès d’Escorza « bossu et handicapé au niveau des jambes, chef de l’investigation sociale du Comité Régional de la CNT-FAI catalane ».
Connaître Escorza, cela voulait dire être au plus près de l’activité de police de la CNT-FAI. Qu’il ait eu ou non une charge officielle dans le Comité Régional de la CNT de Barcelone, José avait eu les moyens de faire libérer Trull.
On trouve aussi dans le dossier de José la déposition d’un témoin « à décharge » : celle de Trinidad Romero de la Cruz, une commerçante de 45 ans, qui déclare en avril 1942 qu’elle rencontra José à Barcelone où elle se trouvait depuis le 24 novembre 1936, cherchant un moyen de passer à l’étranger. Il lui a procuré un passeport et elle a pris le train pour la France le 10 février 1937. Arrêtée peu avant Gérone par la police ferroviaire et ramenée à Barcelone, elle fit prévenir José et elle fut libérée le 11 au soir. Le 12 au matin il l’accompagna lui-même à l’aéroport du Prat, et elle se retrouva à Marseille. Elle conclut ainsi : « Sans avoir d’amitié avec lui, il me traita très respectueusement et avec une véritable attention. »
Autre document à décharge dans le sumario la déposition d’un commerçant vivant dans la rue Baja San Pedro qui déclare en mars 1942 que José est efficacement intervenu en juillet 1936 pour lui sauver la vie.
Et puis un étonnant document administratif « municipal de estadística » sur « la conduite sociale et politique de l’accusé » en date du 14 octobre 1941 essaie visiblement de le décharger quasi complètement ainsi que son ami Taberne Aige. Il y est déclaré que José eut une bonne conduite pendant le « dominio rojo » ; qu’il sauva des personnes de droite ; que dans l’affaire de 1933, on ne savait pas si les explosifs visaient des personnes de droite ou les communistes… Selon les témoins cités, Enriqueta Pellicer « inquilina [locataire] del 35 » et Jaime Juan « el del 22 Carboneria », la mise en liberté de José ne poserait aucun problème pour le « glorieux mouvement national ». Le document est signé du maire.
José connaissait sans doute quelqu’un de haut placé qui intervint – sans succès- à ce niveau-là.
Sinon la défense de José est bien maigre : il déclare avoir travaillé comme chauffeur chez l’avocat de la CNT De Emilio ; mais la déposition en septembre 1941 du portero du cabinet de cet avocat, déclarant que ce dernier n’avait pas de chauffeur et qu’il n’avait jamais vu José, la démolit. On peut quand même penser que José ne citait pas le nom de cet avocat par hasard [32].
Saurai-je jamais quelle sorte de militant fut mon père ? Militant engagé comme il y en eut tant, certes, mais également homme d’action déterminé ? Ou opportuniste ?
Ce dont je suis certain, c’est qu’il fut fusillé le 16 octobre 1942 au campo de la Bota à Barcelone pour s’être opposé les armes à la main au « Mouvement national » de juillet 1936. Avait-il rêvé d’un monde tout autre ? Sans doute…

Il me reste de lui quelques lettres.
Les lettres de José sont au nombre de neuf, échelonnées entre le 26 octobre 1938 et le 13 octobre 1942 (soit trois jours avant son exécution). Trois lettres de José : la première d’octobre 1938 (1) ; la deuxième (2) et la troisième (3) – adressées aux enfants – ne comportent pas de date, mais il est évident qu’elles ont été écrites avant 1939.
Trois lettres sont écrites et signées par Aurelia López (la personne avec qui il vivait), mais c’est lui qui les dictait. La première (4) date du 14 juillet 1940 ; la deuxième (5) sans date mais sans doute de 1940, et la troisième du 20 juillet 1940 (6). Elles commencent toutes par : « Chère cousine ».
Ensuite les trois dernières rédigées après l’arrestation de José : celle du 12 mars 1941 (7), celle du 4 juin 1941 (8) et enfin celle du 13 octobre 1942 (9), toutes dictées par José à Aurelia pendant les visites à la prison.
J’inclus dans ce dossier deux lettres signées « Isidro Lafarga ». En réalité l’auteur en est Fernando, le fils de ma « nourrice » Fernanda Vila ; elles sont datées respectivement du 26 avril 1942 et du 1er septembre 1942.
Le contenu de ces correspondances, joint aux quelques souvenirs de l’enfant que j’étais, m’aident à mieux comprendre les raisons de certains choix et comportements de ma mère que je ne m’expliquais pas bien. Parfois leur contenu laisse perplexe car du fait de la censure et de la répression, tant à Barcelone qu’en prison, chacun se cassait la tête à ne pas dire explicitement les choses.
En premier lieu la mésentente entre mes parents : je suppose que c’est la principale « raison » pour laquelle ma mère décida de quitter José au printemps 1938 et de mettre une frontière entre eux. Reste à connaître les circonstances de cette mésentente qui ont abouti à une décision aussi radicale.
Il y avait sans doute chez elle avant tout l’intention de nous mettre à l’abri des bombardements de Barcelone. Mais il n’y en avait pas à Rosas où était ma sœur, pourquoi aller à Perpignan ? Il est permis de penser que ma mère partait pour ne pas revenir. [33]

Le début de la lettre (1) de José à Lucia illustre l’ampleur de la mésentente ; elle commence par : « Selon toi je ne suis qu’un ami, donc, chère amie… »
Je lis dans un morceau de lettre sans date, de José à Lucia (2) :
« Des fois je me questionne et je pense qu’un idéal entraîne comme conséquence un mal-être dans une famille, et c’est ce qui nous est arrivé. (…) Pour moi, pour une ambition, j’ai laissé ce que je ne devais pas abandonner ; et toi pour une doctrine tu fis ce qu’il ne fallait pas faire. Au point que chérie, si je peux encore t’appeler ainsi, nous avons été deux fous. »
José écrit dans la lettre (8) :
« Chère cousine Lucia, avant autre chose, je voudrais répondre à tes lignes, bien qu’à vrai dire tu continues d’être la même, plus froide que froide, moi j’ai toujours été le même. Je ne veux pas discuter pour savoir qui a raison. (…) Ne t’obstine pas à [illisible] sur mon passé, nous péchons tous dans la vie, moi je n’ai rien à te reprocher, et toi ? »
Il lui avait auparavant confié dans la lettre (5) :
« Le comble de l’imbécillité c’est quand on a la personne que nous aimons le plus avec soi, qu’on n’y attache pas d’importance et que nous cherchons des stupidités pour lui abaisser le moral. (…) Toi tu as tout fait le temps que nous étions ensemble, et moi, qu’ai je fait ? rien… et maintenant que je me trouve seul, j’éprouve des remords et je ne trouve pas les mots pour que tu puisses me pardonner pour tout ce que je t’ai fait. »
Je pense que la raison de cette mésentente profonde repose essentiellement sur la conception divergente que chacun avait de l’engagement militant ; très poussé chez elle, beaucoup plus tempéré chez lui. De ce constat découle leur mal vivre. D’ailleurs José dans sa lettre (2) cerne bien le problème quand il fait référence à l’idéal et à un fort engagement militant qui aboutit selon lui au délitement du couple.
Je pense ne pas me tromper en supposant que lorsqu’ils furent arrêtés pour détention d’explosifs en décembre 1933, José n’était pas dans le secret des dieux.
D’autre part, si je me réfère à la photo contenue dans le dossier de José, montrant mon père promenant une petite fille (ma demi-sœur) apparemment âgée d’environ trois ans (photo prise après son retour à Barcelone et avant son arrestation) on peut raisonnablement penser que cet enfant avait été conçu courant 1937.
Donc il est évident que José avait déjà des relations avec la mère de l’enfant, Aurelia López. Est-ce la raison pour laquelle ma mère décida de rompre ? Sans doute, mais ce ne fut pas la seule.
En février 1939, mon père fit partie des réfugiés qui allèrent peupler les camps d’Argelès, mais comme sa femme vivait en France en toute légalité depuis 1938, il fut libéré et put la rejoindre.
Donc il vécut avec nous quelques mois, difficiles sur le plan matériel car seule ma mère travaillait. Je me rappelle qu’il fabriquait des ceintures en soie que ma sœur et moi allions proposer, sans grand succès, aux commerçants du coin.
Cette situation dura jusqu’à ce qu’il décide de retourner à Barcelone en octobre 1939. La raison de son départ, je ne la connaissais pas vraiment, je supposais plus tard qu’il était retourné en Espagne pour reprendre le combat, ce qui d’une certaine manière me consolait de son absence.
Dans la lettre (8), José justifiait son départ par un courrier qu’il avait reçu de sa famille lui disant que s’il voulait « revenir avec les siens » (!) il pouvait le faire car, selon son père, il n’avait rien à craindre.
Apparemment, nous ne faisions plus partie « des siens ». En clair, il retourna vivre avec la personne qu’il fréquentait jusqu’à la retirada. Ma mère l’avait recueilli à Perpignan, aidé, s’était décarcassée pour nous faire tous vivre ; mais apparemment nous ne pesions guère lourd au moment du choix.
Grâce à l’information que ma fille s’est procurée en fouillant dans les archives barcelonaises, il apparaît qu’il vécut avec sa compagne, non loin de son quartier, et ce sans prendre le soin de changer d’identité.
Comportement qui déplut fortement à ma grand-mère maternelle, Sofia Vidal Prunell, qui ne lui pardonnait pas « sa trahison » vis-à-vis de sa fille et ne supportait pas qu’il « s’affiche » avec sa concubine. Elle s’acharna à lui rendre la vie difficile avant et après l’arrestation.
Dans la lettre (6), José écrit « Je te dirai que l’autre jour j’ai eu la visite de la Sofia, et comme tu peux le comprendre cette visite n’a pas été à mon goût, surtout dans les circonstances où je me trouve. »
À noter que José et sa compagne ont changé d’adresse en juillet 1940 ; la nouvelle apparaît en bas de la lettre : « calle Mora del Ebro, 74 Vallcarca », dans un quartier excentré, où se trouve le parc Güell. Il dit dans la lettre (8) qu’il avait dû y aller pour « respirer un air plus sain ».
D’après le compte rendu de l’enquête diligentée par le juge d’instruction lors de son arrestation en février 1941, il habitait à nouveau à Barcelone à ce moment-là, calle Blay, 42 (Barrio Poble sec).
Dans la lettre (7) écrite environ un mois après son arrestation et envoyée du centre de tri des personnes suspectes qu’était le Palacio de las Misiones, il dit encore :
« En ce qui concerne la Sofia, elle n’a servi qu’à m’occasionner beaucoup de désagréments », ce qui laisse penser qu’elle le « chargea à mort » lors de son arrestation.

On trouve dans la lettre de Fernando (alias Isidro Lafarga) à Lucia du 26 avril 1942, de quoi alimenter les pires soupçons :
« De plus José sera content de travailler là ou il travaille car c’est la tía Sofia qui lui a trouvé la place. »
Faut-il penser que Sofia l’aurait dénoncé ? Pourtant il n’y a pas de déposition d’elle dans le dossier judiciaire : seul un rapport de police du 18 juin 1941 signale que selon « Sofia Vidal Prunell habitant au 35 de la rue Jaime Giralt, l’inculpé abandonna sa femme après lui avoir occasionné beaucoup de soucis ».
Sinon, par cette lettre, Fernando nous informe qu’il avait été lui-même embastillé à ce même centre de tri pendant huit mois, et qu’il s’était retrouvé en compagnie de José. Il ajoute :
« La maison est très bonne ; tu te rappelles quand il travaillait jour et nuit, nous allions le voir le dimanche ; donc c’est la même chose maintenant. »
Il fait allusion aux arrestations de décembre 1933. J’apprends du coup que ma mère, pourtant en cavale, allait donc avec Fernando visiter son mari incarcéré pour la même affaire entre 1934 et 1936. Heureuse époque où l’ordinateur n’existait pas !
La dernière lettre de José (9) date du 13 octobre 1942, sans savoir qu’il était près de son exécution. Curieusement, il se considère hors de danger, au point de faire des projets d’avenir [34] :
« J’espère que tu te décideras à venir. Ton linge, personne n’y a touché. En plus, la Sinta peut te loger, sinon la Fernanda a un lit. En dernier recours, je ferai le nécessaire pour arranger ta situation. »
Trois jours après, il était criblé de balles...
Il ne nous restait plus que les yeux pour pleurer, comme on dit communément. Imaginer la terrible déception qui avait du être la sienne après la bouffée d’espoir qui illuminait sa dernière lettre. Comment a-t-il vécu ses derniers moments ? Question qui vient toujours à l’esprit et ne cesse pas pour autant d’être absurde...
FELIPE RATERO
C’est par l’entremise d’un compagnon de cellule de José que ma mère apprit l’exécution de son mari. Felipe Ratero Pérez s’était apparemment engagé auprès de lui et il écrivit le 19 octobre 1942 à Lucia. Le contenu de la lettre est émouvant et mérite la peine d’être transcrit :
« Chère cousine,
Cette lettre a pour but ce qui suit. Je suppose que tu avais reçu une lettre (celle du 13 octobre que t’avait écrite notre cousin José) et qui avait dû te faire plaisir. Moi-même, ainsi que toute la famille, nous nous étions également réjouis, mais plus tard, notre cousin rendit l’âme à Dieu.
Tu ne peux pas imaginer avec quelle intensité il pensait à toi, jusqu’au dernier moment. Il me disait que s’il arrivait à guérir, il partirait te faire une visite ; il avait très envie de te voir.
Je prie beaucoup pour qu’ils nous donnent cette possibilité, la chance de nous voir un de ces jours, chance qu’il n’a pas eue et que toute la famille lui souhaitait.
J’espère une réponse de ta part si tu reçois cette lettre et que tu me racontes des choses agréables qui puissent conforter ce semblant de vie qui est la mienne actuellement. Ici nous nous divertissons en nous nous remémorant nos “ illusions de jeunesse ”. »
En fait, il y eut un échange de quatre lettres entre Felipe et ma mère, qui dura jusqu’à son exécution : la dernière lettre de Lucia du 8 septembre 1943 lui fut retournée avec la mention « Ejecutado el 9-5-43 ».
Certes je n’ai jamais connu ce jeune homme, mais ses missives étaient « envahissantes », structurées et extrêmement émouvantes. Il est évident que Felipe avait le besoin vital d’un lien avec le monde vivant. Il s’étourdissait de mots, de concepts, s’efforçant ainsi d’oublier l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. On constate que Felipe, comme mon père, a été fusillé quand (allez savoir pourquoi) il croyait être tiré d’affaire.
Il est tout de même curieux de constater que si je ne suis pas arrivé à bien cerner la personnalité de mon père, celle de Felipe, à travers le contenu de ses courriers, me semble parfaitement lisible, touchante au point d’éprouver le besoin de lui rendre hommage.
Conquis par ses certitudes apparemment intactes, en dépit des angoisses et découragements inévitables, il croyait « à en mourir » à un monde juste.
Jordi Gonzalbo, Perpignan, 11 juillet 2011
QUELQUES PRÉCISIONS POUR MIEUX COMPRENDRE CE DOSSIER
Gonzalbo (ou Gonzalvo) Benedicto Joseph, Henri
Fils de Eduardo et Maria
Né le 21 novembre 1902 à Gabian (Béziers) France
arrêté à Barcelone le 21 décembre 1933 ; libéré en février 1936
Arrêté à Barcelone en février 1941
Jugé le 3 juillet 1942 ; la peine de mort est confirmée le 3 octobre 1942.
Exécuté le 16 octobre 1942 au Campo de la Bota
Esteve Vidal Lucia
Née le 26 mai 1903 à Cassa de la Selva (province de Gerona)
Fille de Pedro Esteve Puig et de Sofia Vidal Prunell
arrêtée à Barcelone le 21 décembre 1933
évadée le 27 février 1934
Décédée à Perpignan le 15 novembre 1987
Aurelia López
Compagne de José, sans doute depuis 1936
Meurt entre mars et juin 1941 à Barcelone alors que José est en prison depuis février
A eu une fille avec lui, sans doute née en 1938
Felipe Ratero Pérez compagnon de cellule de José
« Exécuté le 7 mai 1943 au campo de la Bota.
29 ans. Né à Santo Espíritu (Salamanca). Paysan. Célibataire
Confédéral résidant à Esplugues de Llobregat.
Juzgado Militar n° 12 [35] »