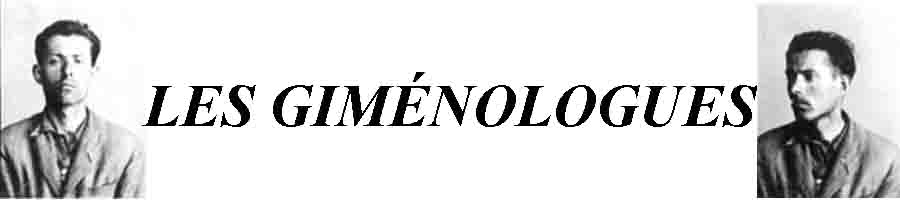Cette publication était en chantier depuis les années 1970 à l’initiative du Groupe Sacco et Vanzetti (FA). La préface de l’époque fut rédigée par Fernando Gomez Pelaez.
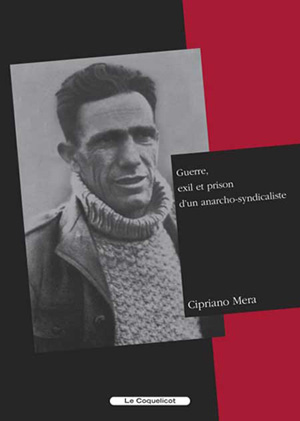
GUERRE, EXIL ET PRISON D’UN ANARCHO-SYNDICALISTE
Cipriano Mera
Editions du Coquelicot
Toulouse, 2011
Préface
La bibliographie de la guerre civile espagnole, extraordinairement abondante — même quelque peu excessive, bien des ouvrages se contentant de se répéter les uns les autres avec la même carence d’intérêt —, laisse encore quelques lacunes à combler. Rien d’étonnant : les grandes commotions politico-sociales du passé eurent, dans leurs racines et leur développement, le même trait commun. Erreurs d’interprétation, déformations ou mensonges grossiers se transmettent de livre en livre pendant des lustres, et parfois des siècles. Le parrainage de certains historiens peu scrupuleux ou l’utilisation par ces derniers de documents ou de témoignages suspects ont suffi à prolonger et à perpétuer la confusion.
Dans le cas espagnol, l’orientation insidieuse des informations officielles durant la guerre, l’interdiction prolongée d’accéder aux archives détenues par les vainqueurs et la destruction, la dispersion ou l’occultation de ce qu’il restait des archives des vaincus — ainsi que la partialité d’un grand nombre de témoignages de récente publication — ont contribué à déformer la signification de la lutte populaire et, plus particulièrement, de l’intervention des diverses organisations du mouvement libertaire dans le secteur de la production industrielle et agraire, dans la vie sociale et dans la lutte armée.
Malgré quelques brèches ouvertes immédiatement après la défaite au travers de la publication d’un certain nombre d’études et de récits de militants de valeur, l’encerclement des falsificateurs a pu se maintenir au long des années en vertu de quelques coïncidences d’intérêt entre adversaires tenaces, de l’un et de l’autre camp. Depuis peu, en échange, la vérité commence à se faire jour : preuve en est le nombre de recherches et d’analyses, dans les universités étrangères ou espagnoles, qui rendent compte de l’œuvre collectiviste et des tentatives de transformation sociale menées à bien, en pleine guerre, dans la zone dite républicaine.
Ces aspects, que la jeunesse découvre aujourd’hui comme autant d’exemples d’organisation sociale « autogérée », sont, sans aucun doute, l’essentiel de l’expérience libertaire des années 1936-1939. Peu nombreux furent alors, en dehors des frontières espagnoles, ceux qui saisirent sa véritable portée. Chaque règle a bien sûr ses exceptions. Dans le cas précis, il est bon de citer celle que constitua le socialiste italien Carlo Rosselli, assassiné en France en 1937 par les cagoulards fascistes d’Eugène Deloncle. Rosselli, en effet, considéra comme un « devoir de justice » d’éclairer l’opinion sur les caractéristiques de l’anarchisme espagnol et, combattant dans ses rangs sur le front d’Aragon, il décrivit dans les colonnes de « Giustizia e Libertà » le « miracle » auquel il assistait, « un miracle, disait-il, dont le secret réside dans l’adhésion de tout un peuple à la révolution, et dans la capacité des syndicats et de ses militants ».
Des opinions de ce genre existèrent, mais n’eurent pas la chance d’intéresser grand nombre, si l’on excepte les militants. Les agences de presse préférent les combinaisons politiques et les hauts faits militaires aux transformations sociales.
Rares étaient les références à l’anarcho-syndicalisme, le plus souvent méprisantes quant à la contribution militaire des libertaires, bien que ceux-ci, dès le début du conflit, aient été parmi les plus nombreux à se mobiliser. Déjà, en zone républicaine, existait cette tendance à la désinformation, malgré l’existence d’une appréciable quantité de publications à caractère révolutionnaire qui, malgré la censure, tentaient de corriger les effets de l’intoxication officielle.
Il existe, de par le monde, des collections plus ou moins complètes de ces publications, des rapports détaillés de certaines unités militaires, mais il semble que ces documents n’aient pas toujours intéressé les chercheurs. Les organismes libertaires eux-mêmes, si l’on excepte quelques évocations des premiers épisodes de la lutte armée et la période des milices, n’ont pas non plus accordé la moindre importance à la participation militaire de leurs militants à la guerre civile. Probablement par répugnance pour la chose militaire, les anarchistes ayant participé à cette expérience — jugée accidentelle par nombre d’entre eux — en ont rarement témoigné. Or, répugnance mise à part, les anarchistes ont largement contribué à la lutte armée républicaine et, en évitant les spéculations partiales ou vaniteuses, il est un fait indiscutable : en faisant abstraction de leur concours, il n’est pas d’explication possible de l’organisation des fronts de guerre, de la résistance opposée à l’ennemi et du développement des différentes opérations offensives de l’armée républicaine.
Néanmoins, la plus grande partie de ce qui a été écrit sur les aspects militaires du conflit espagnol — tant en ce qui concerne les questions techniques que les reportages, mémoires ou récits personnels — reflète des opinions parfaitement tendancieuses et passe le plus souvent sous silence l’existence des unités de la C.N.T., allant même jusqu’à les ignorer purement et simplement dans des batailles qu’elles furent seules à mener. De là naquit la légende qui veut que, tandis que les forces républicaines se battaient, les libertaires refusaient le combat ou préféraient faire bombance à l’arrière-garde. Cette infamie, nous la devons aux communistes et il est inadmissible que perdure ce mensonge grossier. Les débandades, comme les erreurs d’appréciation, ne furent pas moindres qu’ailleurs sur les fronts contrôlés par les communistes. Ce fut plutôt le contraire. La prise en main de l’appareil de propagande par le P.C.E. depuis la création de l’armée régulière permit le colportage de ces mensonges, les communistes sachant parfaitement travestir la réalité en imputant à d’autres leurs lamentables reculs et leurs impardonnables échecs.
Le témoignage offert dans ces pages a, entre autres, le mérite d’exposer de façon simple et concise la participation des unités de la C.N.T. dans un des secteurs géographiques les plus chauds de la guerre civile : la zone du Centre de l’Espagne. Son auteur, Cipriano Mera, militant anarcho-syndicaliste notoire, se trouvait derrière les barreaux de la prison Modèle de Madrid lorsque la rébellion militaire éclata. Dès sa mise en liberté, il prit les armes pour ne plus les abandonner qu’au dernier jour de la guerre. Il nous raconte son expérience sans ambages ni circonlocutions, par le vif. Sans éluder certains aspects doctrinairement discutables, comme la militarisation des milices, Mera, témoin mais surtout acteur, assume l’entière responsabilité de son intervention. Il ne passe rien sous silence et évite les justifications
a posteriori. Il nous dit sa guerre. Et cela l’honore car il fut l’un de ceux qui, avant d accepter l’instauration de la discipline militaire, se montra le plus obstiné défenseur de l’autodiscipline révolutionnaire et soutint, en vain, la nécessité de l’organisation de guérillas qui, déployées en zone ennemie, auraient eu pour mission l’attaque des points névralgiques et la libération des prisonniers dans le but de battre sur leur terrain les forces réactionnaires.
Souhaitée ou non, la militarisation fut imposée par les exigences de la guerre. Les libertaires seuls, insuffisamment armés, ne pouvaient, une fois stabilisés les fronts, imposer leurs conceptions en obligeant les autres forces antifascistes à les accepter. La guerre se prolongeait et l’unité était de rigueur. Devant cette réalité, les militants de la C.N.T. de Madrid — comme ceux des Asturies et du Nord en général, imités par la suite par ceux de la Catalogne, du Levant et du Sud — transformèrent leurs milices en unités régulières. Celles-ci, placées sous commandement unique firent — sur les différents fronts et au cours d’opérations militaires — leur devoir avec courage, avec le même courage au moins que les autres combattants antifascistes. Cela est indiscutable. Quant aux communistes, il convient de rappeler que, par malheur, la direction militaire de la guerre fut entre leurs mains pendant presque tout le conflit. S’il reste à établir certaines responsabilités, ils ne sauraient y échapper. Bien au contraire.
Ce témoignage constitue un avertissement. A travers lui, bien des mythes de la propagande stalinienne s’écroulent : la supériorité des milices communistes, leur prétention exclusiviste quant au rôle joué dans la défense de Madrid, le développement de la bataille de Guadalajara, celle de Brunete, etc. Il n’oublie pas de mentionner la tentative insurrectionnelle « anticapitulationniste » des derniers jours de la guerre à Madrid — tentative réduite par l’unité de réserve du corps d’armée sous le commandement de Mera dans le combat qui l’opposa aux trois corps d’armée d’obédience communiste retirés du front. En ce qui concerne ce point particulier, le récit de Mera, militant aguerri et militaire improvisé, a une valeur documentaire exceptionnelle. Ceux qui souhaitent connaître et comprendre les causes et le développement des événements finaux de la lutte antifasciste dans la capitale devront obligatoirement s’y reporter.
On peut relever, ici et là, quelques carences dans l’explication de certains faits ou questions de détail. Il faut savoir que l’auteur de ce livre n’est pas un professionnel de l’écriture, mais un ouvrier maçon qui, à l’automne de sa vie, a voulu raconter la guerre et la défaite en s’aidant essentiellement de ses souvenirs, parfois aussi de quelques notes conservées. Ce livre est important, tant parce qu’il est le fait d’un militant libertaire qui a vécu des événements essentiels, que par celui d’être écrit dans une langue simple qui nous narre aussi bien les succès que les échecs ou les contrariétés. Mera nous parle de ce qu’il a vu et vécu, de son parcours — de milicien de base à chef de corps d’armée —, de son expatriation en Afrique du Nord et de sa condamnation à mort, de sa captivité après que les autorités françaises eurent accepté, pour leur honte, de le livrer à Franco.
Il reste à dire que, logique avec lui-même et fidèle à sa ligne de conduite, le combattant anarcho-syndicaliste à qui nous devons ce récit vécut pendant la guerre avec la même simplicité qu’avant. Une fois celle-ci terminée, libéré après un long calvaire, il reprit son emploi de maçon sans accorder la moindre importance au rang qui fut le sien et aux honneurs. Ainsi, lorsque, dans les années soixante, un militaire républicain de valeur, réfugié au Mexique, le colonel Perea, vint lui rendre visite à Paris pour obtenir sa collaboration dans une tentative insurrectionnelle quelque peu romantique dirigée contre Franco, Cipriano Mera, tout en affirmant sa sympathie pour le projet, lui répondit de faire abstraction de sa personne et de s’adresser à l’Organisation. Perea insista sur la signification de son concours personnel à l’aventure et fit référence aux victoires passées. La réponse de Mera fut la suivante : « Tout cela a pris fin avec la guerre. Quant à moi, sans renoncer d’aucune façon à la lutte, je ne concède aucune valeur aux galons militaires. Etant redevenu ce que j’étais avant, un maçon, la seule victoire dont je suis fier, c’est celle de la truelle. Le reste n’a pas d’importance. »
Enfin, si cela n’était pas suffisant pour avoir une idée du personnage, de sa droiture, il convient de signaler que, exilé — avec sa compagne Teresa — et vivant des subsides procurés par une très modeste retraite d’ouvrier, Mera refusa obstinément plusieurs offres tentantes — chiffrables en centaines de milliers, peut-être même en millions de pesetas — pour la publication de ce livre à Madrid ou à Barcelone. Certains proches lui signalèrent l’intérêt de la diffusion de ce livre en Espagne, sachant que l’appât du gain ne le déciderait pas. Mera considérait indigne la chose, d’autant que ces propositions lui vinrent lorsque, après l’élimination de l’amiral Carrero, le régime assouvit sa vengeance en assassinant légalement le jeune libertaire Puig Antich. Cipriano Mera répondit en ces termes à ceux qui cherchaient à te convaincre : « Je ne permettrai jamais que mon nom soit négocié en Espagne tant que durera la dictature du bourreau Franco. »
Une telle réaction peut paraître surprenante parce que sentimentale, négative, hors de la réalité, mais elle est le reflet d’une conduite, l’exemple de continuité d’une attitude digne non seulement de respect, mais aussi de reconnaissance et d’admiration. Sans plus.
Fernando Gomez Pelaez
Précisions
Telle était la préface à l’édition espagnole des mémoires de guerre, de prison et d’exil d’un militant anarcho-syndicaliste espagnol. Le livre est aujourd’hui édité en français. L’édition espagnole fut, en son temps, prise en charge par Ruedo Iberico, maison d’édition parisienne de l’émigration antifasciste espagnole. L’auteur du livre n’eut pas la chance de la voir publiée. Cipriano Mera, en effet, fut enterré au cimetière de Boulogne-sur-Seine le 24 octobre 1975. Un mois plus tard, le 22 novembre, disparaissait le général félon Francisco Franco, son plus grand ennemi, celui contre lequel il s’était battu, lui l’ouvrier maçon, à la tête des milices confédérales, puis de son corps d’armée. La proximité de ces deux dates ne diminua pas la peine immense provoquée dans les milieux libertaires par la disparition de ce singulier combattant que fut Cipriano Mera. Aujourd’hui encore, la peine demeure.
La traduction du récit de Mera présentée ici aux lecteurs français ne contient ni retouches ni ajouts quant aux faits signalés et commentés dans l’édition originale. Depuis, ces faits ont été confirmés par divers témoins et historiens soucieux de ne plus se plier aux mythes historiographiques communistes sur la guerre d’Espagne, en particulier ceux relatifs à la bataille de Guadalajara. Il fut un temps où l’histoire avait la fâcheuse tendance d’exagérer le rôle joué par certains et passait soigneusement sous silence les autres. Puis ceux qui, un temps, furent transformés en héros de légende tombèrent aussi vite dans l’oubli dès l’instant où ils entraient en disgrâce : le cas de El Campesino, à qui on attribua longtemps la libération de Brihuega, est, à cet égard, éloquent. Les recherches historiques plus récentes sur la bataille de Guadalajara accordent à la participation de Mera et de ses hommes la part qui leur revient et reconnaissent la droiture et la capacité du colonel Jurado, militaire loyal à la République et non soumis à l’appareil stalinien.
Revenons, maintenant, aux événements de l’automne 1975 et aux espérances mêlées d’inquiétude qu’ils suscitèrent auprès d’un grand nombre d’Espagnols, ceux-là même qui, jusqu’alors, avaient connu la répression ou, pour le moins, le sentiment de vivre sous étroit contrôle policier. En exil ou en Espagne, la question était la même, obsédante et répétée : quelle issue pouvait connaître le régime après la disparition du dictateur, mort dans son lit malgré un certain nombre de tentatives ayant eu pour objet d’abréger son existence et les souffrances de ceux qui subissaient son pouvoir ? D’aucuns imaginaient une évolution du régime vers certaines formes « modernes » de consensus national et se regroupaient en comités, juntes, etc. — tous proposant diverses solutions salvatrices — pour accélérer, suivant en cela certains conseils prodigués à l’étranger, l’alternative « démocratique », seule capable, à leurs yeux, de freiner et de canaliser les aspirations populaires au changement social. Au même moment, certains cédaient aux sirènes d’un gauchisme proclamatoire, mais rapidement exsangue. Dans la même lignée, des groupuscules divers et variés se faisaient les héros de nobles causes, tout en mettant plus d’ardeur à effaroucher qu’à accueillir ceux pour qui ils disaient lutter. Le mouvement syndical, présent dans un certain nombre d’entreprises, avait plus de consistance, mais peu de cohérence. Les aspirations nationalistes faisaient leur chemin, prenant une importance particulière dans leurs centres d’implantation traditionnels. Un peu partout, malgré tout, émergeaient des aspirations libertaires, mais, en dépit de l’énorme capital de sympathies qu’il suscitait, le mouvement libertaire — brutalement réprimé durant la dictature — n’avait pas la capacité d’occuper le terrain qui fut le sien dans la vie syndicale et d’impulser, à travers ses branches traditionnelles (C.N.T., F.A.I, Jeunesses Libertaires et Mujeres Libres), la transformation sociale de l’Espagne et des peuples ibériques.
Tel était le panorama. Il n’y a rien d’étonnant, donc, à ce que la transition ait été ce qu’elle fut. Le petit monde politique de l’opposition institutionnelle consolida peu à peu ses positions et, à mesure que déclinait le franquisme — et, avec lui, que disparaissaient les risques que d’autres avaient encourus dans un passé récent —, il gagna du terrain sur le mouvement ouvrier, étudiant et populaire renaissant des années soixante-dix, dans lequel se situaient les libertaires, toujours sur la brèche et souvent réprimés. Cette opposition, à bien des égards nouvelle et en tout cas moins usée que les forces qui n’avaient cessé de combattre le régime sous Franco, imposa ses règles et, avec le concours de démocrates pragmatiques ou opportunistes, sut — par référendum — rendre constitutionnelle la monarchie instituée par Franco. Tout cela explique que les forces qui — on peut le constater à la lecture de ce livre — surent, pendant la guerre civile, se battre avec courage et efficacité n’aient plus aujourd’hui la même vigueur. Il ne saurait être question, cependant, de tout reprocher aux autres pour éviter d’avoir à regarder en soi-même, en niant l’importance des problèmes internes qui traversèrent le mouvement libertaire en exil et leur répercussion négative en Espagne au moment où la situation permettait la diffusion des idées libertaires et la renaissance des formes organisationnelles de l’anarchisme espagnol. En n’ayant pas su dépasser ses divisions, le mouvement libertaire n’a pas pu répondre aux espérances du présent.
Telle est donc la réalité et, aujourd’hui encore, elle s’impose aux libertaires espagnols. Le renforcement du mouvement en Espagne sera difficile. Il passe en tout cas par la nécessaire prise de conscience de la part de tous ses militants de la volonté de s’entendre pour agir.
Citons, en guise de conclusion, un extrait du livre de J. Llarch, Un anarquista en la guerra de España, consacré à Cipriano Mera. L’auteur y donne la parole à J.M. Molina (Juanel), et ce dernier prononce à propos des obsèques du vieux combattant cette phrase : « S’il avait pu contempler la cérémonie posthume, Cipriano Mera aurait sans doute ressenti la satisfaction de voir réalisé, autour de son cercueil, son rêve d’une C.N.T. réunifiée et sans divisions. » Ceux qui l’ont connu savent bien que tel était, en effet, son rêve. Pour Mera, ce rêve n’était pas le fait d’un vague sentimentalisme. De sa réalisation dépendait l’avenir, c’est-à-dire la capacité de la C.N.T. de répondre à ce qu’allait exiger d’elle la situation socio-politique espagnole à la mort de Franco. Aujourd’hui, tout militant conscient ne peut que donner raison à Mera et regretter que le mouvement libertaire n’ait pas pu, à temps, être l’instrument capable de redevenir ce qu’il avait été. Il aurait fallu, il est vrai, lutter contre une certaine étroitesse d’esprit et remettre en cause certains fonctionnements internes. Cipriano Mera était de ceux pour qui ce combat était nécessaire.
F. G. P.
Quatrième de couverture
Cipriano Mera est né à Madrid le 4 septembre 1897.
D’une famille modeste, il commence à travailler dès l’âge de 13 ans comme manœuvre dans le Bâtiment. Rapidement il adhère au Syndicat du Bâtiment de l’UGT qu’il quitte dans les années trente, le trouvant trop modéré. Il rejoint alors le Syndicat de la Construction de la CNT de Madrid, dans lequel il militera toute sa vie.
Lorsqu’éclate le soulèvement militaire du 18 juillet 1936 il est encore une fois en prison dans la Modelo de Madrid. Le jour même il est libéré par ses compagnons et s’engage dans les milices confédérales. Par la suite, malgré son aversion des galons, il est nommé "Délégué général" de sa colonne confédérale ; il se retrouve en première ligne au moment où les troupes franquistes s’installent sur le front de Madrid. Au début du conflit, il joue un rôle remarquable, participant à la prise d’Alcala de Henares, de Guadalajara et de Cuenca.
C’est alors que la guerre civile prend le pas sur la révolution et les milices sont militarisées, Cipriano Mera accepte difficilement cette transformation. Sans accepter réellement ce tournant politique, il y voit néanmoins un moyen de sauver des vies et de rendre les affrontements militaires plus efficaces.
Il commande alors, avec le grade de lieutenant colonel, le IVème Corps d’Armée et à l’issue de la bataille de Guadalajara défait les troupes italiennes envoyées par Mussolini.
Au moment de la Retirada il se trouve en Algérie puis passe au Maroc. En 1941 les autorités françaises l’expulsent vers l’Espagne. Dans un premier temps, il est condamné à mort puis sa peine est fixée à 6 ans de prison. En 1947 il rejoint la France où il reprend son métier d’origine, maçon. Il le restera toute sa vie.
Continuant à militer à l’intérieur de la CNT, il en est expulsé en 1965 par ses « anciens amis ».
Il meurt le 24 octobre 1975.
Cipriano Mera est encore aujourd’hui le symbole de ces militants simples, prêts au sacrifice, courageux, rebelles, résolus qui se sont battus pendant la révolution espagnole.